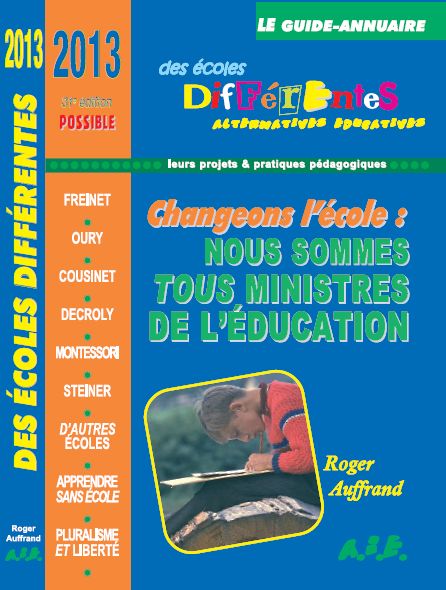Quand les pauvres
vont à l'école
privée
Certains établissements privés, longtemps soupçonnés
de ségrégation sociale, obtiennent aujourd'hui leur classement
en ZEP (zone d'éducation prioritaire). Un intérêt pour
les enfants en difficulté qui ravive la concurrence privé-public.
Emmanuel Saint-Martin - le point 03/03/00 - N°1433
Ségolène Royal aurait-elle d'un souffle ranimé
les braises de la guerre scolaire ? Aux yeux de bien des partisans de l'enseignement
public, elle a en tout cas commis une gaffe. Tout commence en septembre
1999.
D'une lettre, la ministre déléguée à l'Enseignement
scolaire annonce une bonne nouvelle aux responsables de l'enseignement
catholique. Comme ils le demandent depuis de nombreuses années,
plusieurs établissements catholiques vont être classés
en ZEP (zone d'éducation prioritaire).
La missive ministérielle précise même que cette
décision « marque la part de l'enseignement sous contrat dans
l'accueil des élèves en difficulté ».
Trois collèges de Seine-Saint-Denis, sept écoles et collèges
de Marseille et une école de Perpignan, tous situés dans
des quartiers en difficulté, vont donc bénéficier
du même traitement que leurs homologues du public - qui, eux, sont
6 000 en ZEP. Du personnel supplémentaire (surveillants, notamment),
sous la forme d'une majoration du forfait d'externat (c'est le nom donné
aux subventions versées par les collectivités territoriales
et l'Etat pour la rémunération des personnels non enseignants),
et une prime spéciale pour les enseignants.
Dans les mois qui suivent, les établissements concernés
préparent avec les rectorats l'entrée en vigueur de cette
mesure pour la prochaine rentrée. Ils obtiennent même la garantie
que la prime sera versée aux enseignants avec effet rétroactif
à la rentrée 1999.
Mais Ségolène Royal et son cabinet avaient négligé
ce qui n'était pas un détail. Un des établissements
classés en Seine-Saint-Denis, Saint-Benoît-de-l'Europe, est
situé à Bagnolet.
Pas de chance : cette commune héberge aussi le collège
Travail, un établissement public particulièrement combatif.
En pointe lors de la longue grève qui avait agité la plupart
des établissements du département au printemps 1998, il demande
son classement depuis des années. Sans jamais l'obtenir.
Résultat, quand, la semaine dernière, six mois après
la lettre de Ségolène Royal, les enseignants de Travail apprennent,
par une indiscrétion municipale, que le privé voisin passe
en ZEP, ils se mettent immédiatement en grève. Laquelle durait
encore une semaine plus tard.
Pas de nouvelle guerre scolaire !
Au ministère, où l'on vient à peine d'éteindre
l'incendie de la carte scolaire qui s'était déclaré
dans l'Hérault, on ne veut pas d'un nouveau conflit. Et encore moins
d'une nouvelle guerre scolaire ! On fait donc marche arrière, sur
fond - désormais habituel - de dissonances entre les deux ministres,
Allègre et Royal. Le premier semble découvrir la décision
de sa ministre déléguée. C'est fort du soutien de
Claude Allègre que le recteur de Créteil, Jean-Pierre Dedonder,
dément Ségolène Royal. Et explique aux directeurs
des trois collèges de Seine-Saint-Denis comme aux autorités
diocésaines que, tout compte fait, ils ne méritent pas d'être
classés en ZEP...
Même si les établissements de Marseille et l'école
de Perpignan restent classés en ZEP, le coup est rude pour l'enseignement
catholique. « Pour nous, ce classement était le symbole
de l'ouverture à tous de l'enseignement catholique »,
explique Paul Malartre, secrétaire général de l'Enseignement
catholique. Une façon, surtout, de se débarrasser de l'image
d'école de riches qui colle à la peau de l'enseignement privé
(qui est à 95 % catholique). A propos du tollé provoqué
dans l'enseignement public par ce classement en ZEP, Eric de Labarre, président
de l'Union nationale des associations de parents d'élèves
de l'enseignement libre (Unapel), a beau jeu de s'étonner qu'après
« nous avoir fait un procès en ségrégation sociale
on nous reproche de nous intéresser aux enfants en difficulté
».
Les « primo-arrivants »
La nouvelle est d'autant plus difficile à avaler pour l'enseignement
catholique qu'elle intervient à un moment où l'école
privée est, sociologiquement, sortie de la marginalité. Les
travaux de deux chercheurs, Gabriel Langoët et Alain Léger,
jamais démentis, le montrent : si le privé représente
toujours 15 % du primaire et 20 % du secondaire, le nombre d'enfants qui
passent, à un moment ou un autre de leur scolarité, dans
le privé ne cesse d'augmenter. Il dépasse désormais
largement 40 % de la population totale. Certes, les familles les plus modestes
continuent de moins fréquenter l'école privée que
celles des catégories socio-professionnelles les plus élevées.
Mais la concurrence entre public et privé ne se cantonne plus à
une élite sociale et scolaire.
Les écoles et collèges catholiques de Marseille feraient
presque figure d'appartements témoins de ce nouveau terrain de concurrence.
Dans son petit collège Saint-Mauront (cent élèves
seulement), Joël Chamoux, le directeur, recense « 100 % d'élèves
d'origine étrangère et au moins 90 % de musulmans ».
A l'orée des quartiers Nord de la ville, la cité Bellevue
est le lieu de transit de familles arrivant en France. Au fil du temps,
Saint-Mauront s'est donc fait une spécialité de ceux qu'on
appelle en langage Education nationale les « primo-arrivants »,
pour lesquels le français est une langue étrangère.
Paris, 11e arrondissement, lycée professionnel Saint-Joseph.
L'entrée des cours ressemble à n'importe quelle entrée
de n'importe quel lycée professionnel, tendance banlieue. «
Les lycées privés choisissent leurs élèves.
Nous, par vocation, nous choisissons les plus en difficulté. Il
m'arrive même d'en refuser de trop bons ! » assure le directeur,
Jean-Claude Picard. Les 300 élèves sont là pour se
former à la comptabilité, au secrétariat ou encore
passer un CAP de livreur. Ils viennent de toute l'Ile-de-France, souvent
après avoir erré partout. Ils ont entre 14 et 27 ans, sont
« paumés à tout point de vue ». De choix des
familles, il n'est ici guère question. De religion, un peu. Mais,
dans ce lycée adossé à la mosquée du quartier,
le projet de la Compagnie des filles de la charité (soeurs de Saint-Vincent-de-Paul),
qui exercent leur tutelle sur l'établissement, a subi des modifications.
« Dans le projet fondateur, explique Jean-Claude Picard, il est écrit
: "Essayer de montrer aux jeunes que Dieu les aime". Nous, pour le lycée,
nous avons écrit : "Essayer de montrer aux jeunes que Dieu, Yahvé,
Allah les aime". »
Mais, à Saint-Joseph, comme à Saint-Mauront à Marseille,
on est loin de la mixité sociale. La concentration en un même
lieu d'enfants en difficulté pose les mêmes problèmes
que dans le public. Et, si la violence est peut-être moins prononcée
que dans certains gros établissements publics, le conseil de discipline
de Saint-Joseph a tout de même exclu cette année deux élèves
pour faits de violence contre des adultes.
Au collège Saint-Joseph de Pantin, le directeur, Guy-Victor Lambert,
ne connaît guère ces problèmes. Pourtant, lui aussi
revendique l'accueil d'enfants de familles en difficulté. Mais il
veut, dit-il, « tout faire ». Aussi bien l'enseignement spécialisé
que le collège classique, qui mène au lycée. N'empêche,
dans les collèges publics voisins, on ne se départit pas
du soupçon de favoritisme. En clair, même s'il accueille des
enfants de familles modestes, celles-ci seraient, en général,
plus impliquées dans la scolarité de leurs enfants. Guy-Victor
Lambert l'admet d'ailleurs : « Nous avons sans doute plus facilement
accès aux familles que nos collègues du public. » Mais
c'est aussi pour faire entendre que l'enseignement catholique fait peut-être
plus d'efforts dans ce sens : « Ce qui fait que la situation reste
gérable malgré les difficultés, c'est qu'on cherche
à voir beaucoup les familles. On essaie de ne rien laisser passer.
»
Un encadrement plus serré
Car, dans la volonté de l'enseignement catholique de manifester
son intérêt pour les banlieues, il y a aussi le souci de montrer
son « avantage comparatif ». La taille des établissements,
d'abord, qui permet un encadrement beaucoup plus serré, auquel les
parents sont très sensibles. Et puis la stabilité des équipes,
aussi bien des chefs d'établissement que des enseignants, qui contraste
avec le jeu de chaises musicales de la plupart des collèges publics
de ZEP. Sans doute faut-il ajouter une différence d'approche des
enseignants.
Selon une enquête d'un syndicat d'enseignants, la FEP-CFDT, les
profs du privé se distinguent par une plus grande motivation pour
la pédagogie, tandis que ceux du public marqueraient un attachement
plus fort aux disciplines, aux contenus. Le président du Syndicat
national des directeurs de collèges privés (Synadic) revendique
même pour l'enseignement catholique la paternité de «
beaucoup des réformes lancées dans le public pour prendre
en compte l'intérêt des élèves. L'idée
de communauté éducative, celle de professeurs coordinateurs,
mais aussi l'attribution d'une salle de cours par classe, tout cela vient
de l'enseignement catholique ».
Reste que ce déplacement de la concurrence public-privé,
qui quitterait l'élite pour arriver sur le terrain des élèves
en difficulté, a ses limites. Géographiques, d'abord : les
établissements privés sont presque tous d'implantation ancienne,
et donc peu présents dans les banlieues. Une étude conjointe
de l'Insee et de l'Ined, publiée en 1992, montrait ainsi le lien
très étroit entre la forte implantation de l'école
privée et la diversité sociale des familles qu'elle accueille.
En clair, dans l'Ouest, où le privé scolarise jusqu'à
40 % des élèves, les familles modestes y sont en nombre,
d'autant plus que les droits de scolarité, au collège, excèdent
rarement 150 francs par mois, souvent beaucoup moins. En revanche, Paris,
qui cumule à la fois un faible taux de scolarisation en privé
et une forte présence d'établissements catholiques prestigieux,
contribue grandement à l'image d'écoles de riches.
Mais il faut aussi compter avec les réticences des parents d'élèves
du privé devant la diversification des origines sociales des enfants
accueillis. « Certains des parents voudraient effectivement être
socialement protégés », admet Paul Malartre. A Pantin,
par exemple, il n'est pas rare que la « clientèle »
traditionnelle de l'école privée préfère aller
rejoindre les collèges plus huppés de Paris intra-muros.
Reste que ce comportement n'est pas une exclusivité du privé.
L'Insee et l'Ined ont montré qu'à l'intérieur même
de l'enseignement public certains parents, mieux informés que les
autres, ont les moyens de choisir l'établissement de leur enfant.
Bref, font un usage privé, consumériste, du système
public.
----------------------------------
Allègre contre le classement
des lycées
Claude Allègre n'aime pas l'idée que les familles puissent
choisir un lycée. « Convictions républicaines »
obligent, il est très strictement attaché aux carte scolaire.
Du coup, l'habitude prise par le ministère de l'Education nationale,
depuis plusieurs années, de publier les résultats au baccalauréat
de chaque lycée ne lui plaît guère. D'autant qu'elle
donne lieu en général à la publication dans la presse
de classements et de palmarès de nature à nourrir le «
consumérisme scolaire ».
Jusqu'à il y a deux ans, le ministère vendait - pour 50
000 francs - aux journaux les résultats collectés par la
Direction de l'évaluation et de la prospective (DEP). Depuis, ils
étaient distribués gratuitement. Un moment tenté par
la suppression pure et simple de cette publication, Claude Allègre
a finalement renoncé. Fin mars, la presse publiera donc les indicateurs
officiels et les traditionnels palmarès. Avec toutefois une contrepartie
: il leur faudra également publier un encart concocté Rue
de Grenelle. Une sorte d'avertissement au lecteur sur la façon de
lire et d'interpréter les indicateurs.
Si Allègre a renoncé à faire de la résistance,
c'est qu'elle est apparue rapidement vaine. D'abord, des classements étaient
publiés avant que le ministère communique ses chiffres officiels.
Surtout, la demande publique en la matière est très forte.
Pas seulement chez les tenants de l'enseignement privé, car le public
a également son lot de lycées prestigieux qui tirent argument
de leurs bons résultats, aussi bien dans leur concurrence avec le
privé que dans celle qu'ils se livrent parfois avec des établissements
publics.
La publication récente, au Seuil, d'un « Guide des lycées
d'Ile-de-France » prouve en tout cas qu'une offre est toute prête
à répondre à cette demande. L'historien Jacques Marseille,
reconverti dans l'édition, qui est à l'origine de cette publication,
assure qu'il n'est « pas question d'établir un palmarès
des lycées ».
N'empêche, il s'agit bien de distinguer les bons lycées.
Donc d'écarter les mauvais.
E. S.-M.