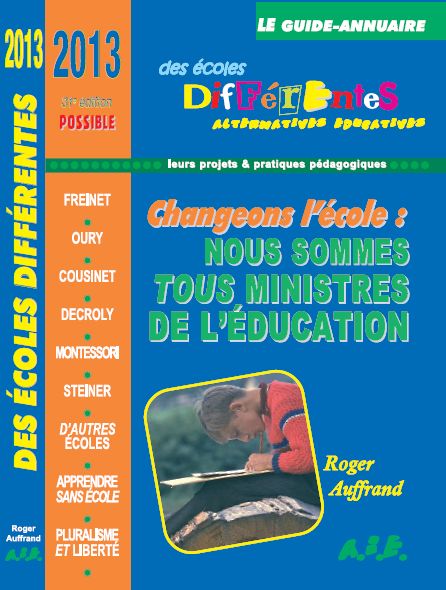| Des
écoles publiques "expérimentales"
SUMMERHILL
SCHOOL
LE
MOUVEMENT FREINET AU JAPON
(Tsuneo
FURUSAWA, Université Hosei, Japon)
JAPON
: Les écoles de la liberté
Violence entre
élèves au Japon :
au
cours des deux derniers mois, au moins sept élèves se sont
suicidés.
School holdouts show first ever
drop for consecutive years
The number of children refusing to attend school dropped by 3.8 percent
last fiscal year, the first time consecutive declines have been recorded
since records began in fiscal 1991, the government said.
Despite the 5,040 decline, there are still 126,212 children in Japanese
elementary or junior high schools who refuse to attend class.
Last fiscal year was the first time in five years that the number of
school holdouts fell below 130,000.
Officials from the Ministry of Education, Culture, Sports, Science
and Technology attributed the decline to an improved support system for
children struggling with school, but added they would continue to work
toward eliminating the problem.
Ministry officials said that there are 24,086 elementary school children
refusing to go to school and another 102,126 children doing the same at
junior high school.
(Mainichi Shimbun, Aug. 15, 2004 - Japan
National News) |
Persécutés
dès le préau au Japon
Pris en grippe et marginalisés,
10% des «Ijime»
tentent de se suicider. «Rejetés
par les autres, les "Ijime" sont seuls face à la meute.»
Shinao Ubukata,
aide sociale de la mairie de Tokyo
Par RICHARD WERLY - Libération - Le mercredi
5 septembre 2001
Tokyo de notre correspondant
«Aimerais-tu
que l'on place des cafards dans ton cartable ?
Que dirais-tu si on te traitait de laideron ?
Si on gribouillait des insultes dans ton agenda
?»
Dans la cour d'une école publique du quartier de Shinjuku, à
Tokyo, Kimie Hirano ressasse ses questions dérangeantes devant des
grappes d'ados. En ce début septembre, l'heure de la rentrée
sonne pour des millions de jeunes Japonais.
Les cartables sont neufs. Les uniformes - chemise blanche
et pantalon ou jupe bleus - sont bien repassés. Le meilleur moment,
selon Kimie Hirano, pour «secouer les esprits» et repartir
en guerre contre le problème des enfants persécutés
ou Ijime. A 43 ans, cette mère de famille est, avec
d'autres parents, à l'origine d'un réseau unique de volontaires
qui s'efforce de mobiliser enseignants et élèves contre cette
pratique détestable que tous ont un jour ou l'autre côtoyée.
Kimie parle et interpelle. Elle met le couteau dans cette plaie du système
scolaire nippon. Bien décidée à éviter que
ne se reproduise, dans les établissements qu'elle visite,
la tragédie qui, un jour de 1994, lui a pris son enfant.
Pris en grippe.
Kimie Hirano est la hantise du «Mombusho», le ministère
de l'Education. Depuis sept ans, cette résidente de la
province de Kanagawa, près de Tokyo, remue ciel et terre pour
que le gouvernement agisse enfin contre le phénomène des
Ijime. Avec toute l'énergie du désespoir d'une mère
traumatisée. Kimie Hirano et son mari Shinya avaient un fils, Yo.
En 1994, leur garçon s'est suicidé parce qu'il n'en pouvait
plus d'être un Ijime, un gamin montré du doigt et marginalisé
dans son collège de Tsukuimachi. Yo Hirano avait 14 ans et le malheur
de déplaire physiquement à quelques-uns.
«Dès
que ses camarades l'ont pris en grippe, sa vie scolaire s'est transformée
en enfer», se souvient Kimie. Yo retrouve ses cahiers bourrés
de graffitis. Il est molesté. Pendant les cours, ses erreurs
provoquent des moqueries. Jusqu'au suicide... Naoko Tonaki est lycéenne.
Elle a vécu le martyr d'une enfance Ijime: «Au collège,
une fille jalouse me persécutait parce que j'avais de l'acné.
Toutes mes copines m'ont lâchée. J'ai fini par changer
d'école.» Le culte japonais du groupe rend ce sadisme
effroyable: «rejetés par les autres, les "Ijime" sont
seuls face à la meute», confirme Shinao Ubukata, du service
d'aide sociale de la mairie de Tokyo.
Le cas tragique de la famille Hirano et du suicide de son fils
Yo est revenu en début d'année sur le devant de la
scène au Japon. En janvier, Kimie et son époux, Shinya ont,
chose rare, obtenu que soient condamnés en justice la Municipalité
de Tsukuimachi, l'école Nakano que fréquentait leur fils
Yo et neuf des adolescents coupables de l'avoir persécuté.
41 millions de yens (environ 386 000 euros) de dommages et intérêts
leur ont été accordés. Mais cette victoire judiciaire
n'est à leurs yeux qu'une étape. Car le problème est
grave: 10 % des enfants Ijime, épuisés, tentent au
moins une fois de mettre fin à leurs jours. D'autres choisissent
de sécher les classes. Le ministère de l'Education
estime à 26 000 le nombre d'élèves des écoles
primaires portés manquants, l'an dernier, après avoir été
victimes de discrimination. Agés en général de 8 à
15 ans, bon nombre d'Ijime deviendront ensuite Hikikomori,
ces ados reclus (voir Libération du 26 juillet 2001), coupés
de leur famille et du monde extérieur.
Le phénomène tribu.
La crise économique dans laquelle l'archipel est englué
n'arrange rien. Les enfants métis, les ados japonais originaires
d'Amérique latine, les Coréens immigrés dans l'archipel
ont longtemps souffert de ces persécutions. Mais aujourd'hui, les
enfants de parents en difficulté, suite à la perte d'un emploi
ou à un déménagement, sont les nouvelles cibles. «S'il
n'a pas les épaules assez solides, un gamin qui a un père
au chômage devient très vite "Ijime"», confirme
le psychiatre Hidehiko Kuramoto. Les forums Internet fréquentés
par les ados japonais témoignent d'ailleurs de cette inquiétude:
«Que
dois-je dire à mes copains si mon père se retrouve sans boulot?»,
interroge, sur le site populaire de Channel 21, Hiroshi, 15 ans, dont les
deux parents travaillent chez Fujitsu, le géant électronique
qui s'apprête à licencier en masse. Le phénomène
«tribu», très répandu au Japon, et la consommation
reine n'arrangent rien: «Dans ma classe, tout le monde se moque
d'un garçon parce qu'il n'a pas de "Ketai" (téléphone
portable)», note sur le même site Michiyo, une collégienne.
Et d'avouer, penaude: «Je lui ai conseillé d'en acheter
un faux. Comme ça, je n'aurais pas honte de sortir avec lui...»
Le vrai responsable du phénomène Ijime est,
bien sûr, le système éducatif japonais. Réputées
pour leur discipline de fer en matière de travail scolaire, décriées
pour la pression qu'engendre sur les élèves le bachotage
systématique, les écoles négligent les rapports humains.
Le comportement des professeurs, placés sur un piédestal
par le système, laisse aussi à désirer. «Beaucoup
vivent dans leur tour d'ivoire et ignorent leurs élèves.
Ils se moquent de savoir si l'un
ou l'autre est mal dans sa peau», accuse Kimie Hirano.
Pire: certains profs abusifs persécutent à leur tour les
Ijime
parce qu'ils pleurent en classe ou qu'ils travaillent mal, sans chercher
à savoir pourquoi.
Cercle vicieux.
La persécution des Ijime est enfin renforcée par
la montée de la criminalité en milieu scolaire. Comme en
Europe ou aux Etats-Unis, les écoles japonaises sont gagnées
par la violence. Les agressions deviennent fréquentes. Le harassement
moral dans les écoles augmente d'autant plus qu'il est peu réprimé.
La seule loi sur la sécurité scolaire en vigueur au Japon
date de1983. Elle permet de renvoyer les élèves qui commettent
des actes de violence physique ou
sèchent les cours. Mais aucune sanction n'est prévue
contre les persécutions psychologiques. La culture japonaise du
groupe et les carences législatives assurent l'impunité aux
meneurs.
«Ceux qui persécutent les plus faibles triomphent
car tout le monde est désemparé et tétanisé,
explique Naoko Tonaki, ex-adolescente Ijime. La direction de l'école
refuse d'en parler au rectorat pour ne pas être mal notée.
Les profs rechignent à en parler aux parents pour ne pas se retrouver
accusés. Les camarades de classe n'interviennent pas par peur d'être
marginalisés. C'est un cercle vicieux.».
Le Japon, l'île
des enfants perdus
A Tokyo, les jeunes qui n'ont pas les moyens de se loger louent des
box dans des cafés Internet, qui fonctionnent 24 heures sur 24 et
offrent de nombreux services : location de DVD, bibliothèque, restauration
etc.
Souvent d'un confort feutré avec leurs spacieuses bibliothèques
de mangas et de DVD, leurs box au fauteuil moelleux séparés
par de minces cloisons à mi-hauteur et leurs distributeurs de boissons,
sandwichs ou bols de nouilles instantanées, les cafés Internet
qui fonctionnent 24 heures sur 24 sont les nouveaux repaires des jeunes
Japonais.
La plupart viennent pour surfer sur le Web, d'autres pour tuer le temps,
regarder la télévision ou se reposer dans la pénombre
d'un lieu confortable, loin du brouhaha des rues des quartiers animés.
Certains en ont fait leur tanière. Ce sont les "réfugiés
du Net" : des jeunes de 20 à 30 ans qui naviguent d'un petit boulot
à l'autre et ne gagnent pas assez pour se payer un logement ou une
chambre d'hôtel. Dans les cafés Internet, ils peuvent passer
six heures pour 1 500 yens (9 euros) ou moins dans les quartiers périphériques.
La plupart des grands établissements disposent d'une centaine de
box.
Minuit passé. Devant la machine à boissons chaudes, il
attend que son gobelet se remplisse. La trentaine, jeans et tee-shirt bleu,
les cheveux en broussaille. "Cool" comme des milliers de ses congénères
croisés auparavant dans les rues du quartier branché de Shibuya
à Tokyo. "Vous, vous cherchez un nouveau pauvre ?, dit-il, avec
un sourire amer. Bingo ! Vous l'avez. Trente ans, une vingtaine de boulots
sans lendemain. Depuis trois mois, je vis ici avec un petit sac et des
sous-vêtements jetables. Je suis un "one call worker" : enregistré
auprès d'une agence de placement qui m'appelle sur mon portable
quand il y a un boulot. Dans les 1 000 yens de l'heure. Je dépense
1 500 yens pour ma nuit. Je mange dans des McDo. Humiliant, non ? Le gouvernement
parle de "seconde chance" pour les perdants comme moi, poursuit le jeune
homme. Mais y en a marre : on ne quémande pas une chance, un coup
de bol. On veut une vie décente, c'est tout. Mon nom ? Je suis personne
dans cette société." Dans le gobelet, le café refroidit.
Il le prend, puis, sur un "Salut !", part vers son box.
Les cafés Internet offrent un condensé de la société
japonaise contemporaine : prospère, lisse et efficace en surface,
mais parcourue d'ondes souterraines dénotant malaise et dysfonctionnements.
Dans les cafés Internet les plus modernes, ceux des quartiers animés,
l'accueil est digne d'un hôtel. Atmosphère feutrée
et services multiples. Fondus parmi les clients - car rien dans leur apparence
ne les distingue vraiment - se nichent les jeunes paumés.
Après une décennie de récession, la machine productive
nippone est repartie, mais elle laisse sur le carreau nombre de jeunes.
Ce sont des "freeters" (mot composé de l'anglais free
et de l'allemand arbeiter, désignant ici ceux qui font des
petits boulots, c'est-à-dire des jeunes en situation précaire).
Ayant grandi dans le Japon de la "bulle financière" de la fin des
années 1980, ils sont arrivés sur le marché du travail
à la fin de la "période glaciaire" de la récession,
quand les entreprises soucieuses de réduire les coûts ont
sabré dans l'emploi permanent pour privilégier le travail
temporaire. Ils forment ce que le quotidien Asahi a baptisé la "génération
perdue".
Le gouvernement estime à 1,8 million le nombre des freeters,
filles et garçons. Si, au début de la décennie, on
a pu voir en eux l'expression des valeurs individualistes d'une génération
plus orientée vers des satisfactions personnelles que ses parents
dévoués à l' entreprise, beaucoup ont découvert
que leur situation est moins synonyme de liberté que de précarité.
Aux largués de la reprise, freeters et jeunes désargentés
arrivés de la campagne qui n'ont pas de quoi payer un loyer et encore
moins les trois mois d'avance pour obtenir un logement s'ajoutent ceux
que des sociologues anglais ont baptisés "neet" (Not in Education,
Employment or Training). Ils ne sont pas étudiants ni en formation
: ils dérivent. D'entrée de jeu, ils ont baissé les
bras. Pour la plupart, ce sont des adolescents introvertis qui refusaient
d'aller à l'école (phénomène préoccupant
dans l'Archipel depuis une décennie). Adultes, ils restent refermés
sur eux-mêmes. Ils seraient 800 000.
Les neet sont un symptôme du malaise d'une société
devenue férocement compétitive, qui condamne leur inadaptation,
la mettant au compte de la fainéantise. Un message qu'ils reçoivent
comme une négation de leur droit à l'existence. Les neet
forment une bonne partie des jeunes qui se suicident. Comme eux, beaucoup
de freeters ont le sentiment d'être pris dans une nasse.
Les quelque deux mille cafés Internet que compte le Japon sont
moins chers qu'un sauna ouvert toute la nuit ou que les "hôtels capsules",
aux couchettes superposées comme dans un wagon-lit. Et les boissons
sont gratuites. La nuit, les plus grands sont pleins.
Outre la faune des habitués (10 % selon les employés),
qui viennent pour quelques semaines, voire quelques mois, on y côtoie
des salariés qui ont raté le dernier train. Ils ronflent
les pieds sur la tablette de l'ordinateur dans les fauteuils inclinables
des petits box de 2 m2, où l'on se déchausse avant d'entrer.
Çà et là, dans les compartiments à deux, des
couples profitent de la pénombre complice pour se caresser discrètement.
Certains sont des lycéens qui ont raconté à leurs
parents qu'ils dormaient chez un copain ou une copine. Devant d'autres
box sont posées des chaussures à talons hauts : des filles
de la nuit (hôtesses de bar et autres) qui attendent les premiers
métros. Au petit matin, tout ce petit monde s'ébroue vers
les douches de l'établissement. Certains ont même une salle
de sport.
Les réfugiés du Net sont l'une des facettes de la nouvelle
pauvreté nippone, fille d'une inégalité croissance
entre ceux qui ont un travail fixe et les autres. Une disparité
qui passe désormais par un clivage entre générations.
Philippe Pons
La
révolte molle des jeunes paumés
"Nous ne sommes plus à l'ère du prolétariat, mais
du précariat", lance Karin Amamiya, reprenant le mot forgé
en Europe pour désigner un état de précarité
permanent. |