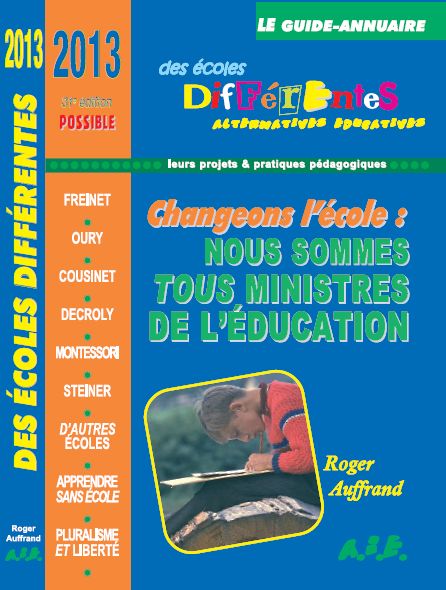Quelques
autres "rubriques", parmi beaucoup d'autres, toujours d'actualité
:
les rapports
parents-profs, la maternelle
à 2 ans, l'ennui
à l'école, les punitions
collectives, le téléphone
portable
, l'état des
toilettes,
le créationnisme...
Un rapport de deux inspecteurs
généraux, interdit de publication par le ministère,
offre un premier bilan :
La
suppression de la carte scolaire renforcera les ghettos
L'imposture
de la "mixité scolaire" à Paris
La
suppression de la carte scolaire « est un très grand succès
».
...
Sauf qu'il y a un truc dont le rectorat ne s'est guère vanté.
C'EST
LE PRIX DU M² QUI FAIT LA DIFFERENCE...
La
carte scolaire et l'apartheid
A
l'école des inégalités
En
dépit du contrat républicain, l'ascension sociale par le
mérite scolaire reste en panne.
| La mixité sociale
au ban de l'école
Une étude montre que, sur l'académie de Bordeaux, 10 % des collèges concentrent 40 % des élèves issus de l'immigration. Témoignages. Libération - Par Michaël HAJDENBERG - jeudi
27 octobre 2005
Avant de théoriser la discrimination positive, le constat de
la discrimination «négative» s'impose. Il a été
récemment posé par les sociologues Georges Felouzis, Françoise
Liot et Joëlle Perroton dans leur ouvrage au titre provocateur, l'Apartheid
scolaire (1), qui tente de décrypter les stratégies de choix
des parents lors de l'inscription de leur(s) enfant(s) dans une école.
Dans quel collège l'inscrire ? Celui du secteur, qu'on dit mal famé
et de niveau médiocre ? Celui d'un quartier chic voisin, pour lequel
il faudra obtenir une dérogation ? En travaillant sur les prénoms
de 144 000 élèves de 333 établissements publics et
privés de l'académie de Bordeaux une méthode
très critiquée mais qui est la seule permettant de contourner
le refus républicain de comptabiliser les élèves selon
leurs origines , les trois sociologues ont établi que 10 %
des collèges concentrent 40 % des élèves issus de
l'immigration.
«Ne pas faire du collège un ghetto»
«J'ai une certaine sensibilité, je suis bénévole pour aider des enfants en difficulté, mais je ne vais pas aller droit dans le mur pour des idées. Ma fille aînée était à Edouard-Vaillant. Mais attention : elle a pris portugais dès la sixième pour pouvoir être acceptée en seconde à Camille-Julian [bon établissement hors secteur]. En primaire, même les instits vous le disent : "Si vous voulez que votre enfant réussisse, ne le mettez pas à Edouard-Vaillant." En même temps, on ne peut pas faire de ce collège un ghetto. Sinon, ça risque de nous péter un jour à la gueule. Et puis ma fille aînée m'a bien dit que les rumeurs de viols et de drogue étaient fausses. J'y ai donc mis ma deuxième, qui a choisi le portugais également. Sauf que, cette fois, ils ont mélangé ceux qui font portugais, dont beaucoup viennent du Cap-Vert, et ceux qui font arabe. Cela fait beaucoup d'enfants dont la langue maternelle n'est pas le français. Or, pour que la mixité fonctionne, il faut un équilibre. Je me pose sérieusement des questions pour le dernier, qui est en CE2. Je ne vais quand même pas lui faire faire russe en première langue pour qu'il soit dans un autre collège. De toute façon, ce sont toujours les enfants de médecins ou d'architectes qui obtiennent plus facilement des dérogations. Alors, parmi les gens plus modestes, on en voit beaucoup se tourner vers le privé. Sauf que nous, avec trois enfants, ce n'est financièrement pas possible.» «Je veux la mixité, pas l'insécurité»
«J'ai trois enfants. Pour le petit dernier, Louis, qui est en CM1, je me pose des questions que je ne me posais pas il y a quelques années. Il doit aller à Edouard-Vaillant, comme son frère aîné, qui a aujourd'hui 20 ans et qui y a fait une bonne scolarité. Il dit qu'il a fait de super voyages grâce à l'établissement, qu'il a eu beaucoup de bons profs. Mais maintenant on voit des voitures de flics devant l'établissement, et j'ai envie de protéger Louis, même si je ne sais pas trop de quoi. C'est peut-être une question de population. A Edouard-Vaillant, il y a 21 nationalités. Pourtant, j'aime mon quartier. Je ne m'y suis jamais sentie en danger. Je suis militante associative dans différents combats pour faciliter l'intégration. Et je trouve que les ghettos, c'est insupportable. Je veux la mixité. Mais pas l'insécurité. Je sais bien que plus l'effet ghetto s'accentuera, plus l'insécurité grimpera. Mais à Edouard-Vaillant, il y a quand même beaucoup d'enfants très abîmés. Edouard-Vaillant, c'est le choix du coeur. Mais le choix de la raison, c'est d'aller ailleurs. On est obligé de faire des choix différents de ce qu'on ressent.» «Les gens fantasment la violence»
«Tout le monde est pour la mixité sociale. Mais pour les autres. A Edouard-Vaillant, on reçoit plus d'élèves en difficulté qu'ailleurs. Mais les bons, ils sont bons partout. Les gens fantasment les phénomènes de violence. On doit encore réparer une réputation qui date d'il y a quinze ou vingt ans. En fait, on ne va pas à Edouard-Vaillant, mais on ne sait plus pourquoi. Moi je vends le collège, je fais le VRP. J'invite les parents et les enfants à visiter l'établissement. Il y a deux ans, j'ai même prêté la cour pour une kermesse de l'école primaire. Des élèves du collège ont voulu entrer. Les parents n'ont pas su gérer. Au lieu de me prévenir, ils ont appelé les flics. Tous les parents les ont vus et ça les a marqués, alors que, en quatre ans ici, je n'ai jamais eu à appeler les flics. Avec une histoire bête comme celle-là, on fait dix pas en arrière. Mais, pour certains parents, tous les moyens sont bons pour éviter le collège. Le quartier se découvre ainsi une formidable communauté russophile ! Ça m'agace que notre travail ne soit pas reconnu et ça m'agace qu'on stigmatise nos élèves alors qu'ici, ils apprennent la tolérance.» (1) L'Apartheid scolaire. Enquête sur la ségrégation
ethnique dans les collèges, Seuil, 233 pages, 19 euros.
La mixité sociale, oui... mais loin de chez moi CÉCILIA GABIZON - Le Figaro - 20 novembre 2006
Un sondage TNS-Sofres pour le compte de Nexity, que révèle
« Le Figaro », prouve que le pouvoir d'achat reste le principal
clivage de notre société. Plus que la religion ou l'origine
sociale.
LES AMÉRICAINS ont inventé un mot qui pourrait fleurir
par ici : Nimby, qui signifie, « pas dans mon jardin ». En
France, la dernière enquête menée par TNS-Sofres, pour
le compte de l'Institut pour le logement de Nexity, dévoile combien
l'idéal de mixité sociale reste fort, mais aussi qu'un nombre
croissant de Français en reste plus à l'idée qu'à
sa concrétisation à côté de chez eux. La question
du logement est à ce titre révélatrice. Près
de 67 % des Français interrogés sont favorables à
la construction de HLM près de chez eux, tandis 30 % s'y opposent.
Surtout, l'immense majorité préfère que soient construits
à proximité de chez eux des logements en accession à
la propriété (83 %). « Confrontés à l'éventualité
de nouveaux arrivants dans leur quartier, les Français privilégient
par conséquent des populations plutôt aisées au détriment
de foyers plus modestes », analyse l'institut de sondage. Ceux qui
vivent dans des villes avec peu de logements sociaux veulent largement
préserver ce cadre et 40 % se montrent hostiles à l'implantation
de HLM.
Les 18-34 ans plus ouverts Ces réflexes de crainte concernent surtout les propriétaires,
qui veulent préserver « la valeur » de leurs biens.
Or, l'image des classes populaires fait peur, comme si leur présence
allait entraîner une dégradation de l'environnement. Globalement
perçue comme une source d'apaisement dans la société,
la mixité sociale et ethnique apparaît plus risquée
à l'échelle individuelle. Un Français sur quatre ne
« souhaite pas le mélange de population ». Ces opinions
suivent les lignes de fracture politique. « Les sympathisants du
Parti socialiste sont 88 % à juger la mixité souhaitable,
tandis que ceux de l'UMP ne sont que 68 % », précise TNS-Sofres.
Et parmi ceux qui soulignent l'importance de la mixité ethnique,
ils ne sont plus que 22 % à la privilégier à l'échelle
de leur quartier, lui préférant le mélange des générations.
Seuls les 18-34 ans se montrent plus ouverts à la diversité
ethnique autour d'eux puisqu'un tiers l'encourage dans son quartier. Le
désir de mixité augmente aussi avec le revenu. Ce sont finalement
les couches populaires qui s'y montrent les plus rétives. «
Comme si l'arrivée de population plus aisée ne ferait que
souligner la relégation qu'ils vivent, comme si cela pouvait les
déposséder de leur quartier », explique TNS-Sofres.
Car dans une société française désormais focalisée
sur le clivage d'argent et le pouvoir d'achat, la communauté de
destin dans le quartier rassure. « En ce moment, il existe une demande
d'entre-soi, mais il serait démagogique de suivre l'opinion »,
fait valoir Robert Rochefort, du Crédoc, chargé de réfléchir
à l'avenir du logement pour l'institut Nexity. « La logique
du marché - avec une segmentation sociale marquée, des prix
au mètre carré qui amènent des personnes de même
standing dans un quartier - conduit vers la ségrégation »,
met en garde le sociologue.
Effet d'entraînement positif Or la mixité n'est pas seulement une belle idée, à en croire les études conduites par le sociologue Hugues Lagrange sur des cohortes d'adolescents. Dans les quartiers populaires, lorsque la proportion de cadres et de professions intermédiaires dépasse, même très légèrement, les 5 %, « la probabilité d'être impliqué dans des délits baisse systématiquement. » En clair, il suffit de très peu de cadres pour créer un effet d'entraînement positif. Reste qu'aujourd'hui, nombre de quartiers sensibles des banlieues ne comptent pratiquement plus de professions intermédiaires. En revanche, à Paris et dans les agglomérations qui disposent d'un centre attrayant, la mixité se maintient mieux. En réalité, Le Ghetto français, récemment évoqué par le sociologue Éric Maurin, se manifeste surtout, aux deux extrémités, pour les plus riches et les plus pauvres, selon une enquête tout juste conclue par Edmond Préteceille, chercheur au CNRS (La Preuve des inégalités, éditions des PUF, à paraître en décembre). En revanche, la mixité se maintiendrait, voire progresserait, ailleurs, selon cette enquête menée sur la base des recensements de 1990 et 1999 en Île-de-France. Le chercheur parvient à un indice de mixité sociale de 20, sachant que 100 montrerait une ségrégation totale et 40, une mixité ethnique (sur la base des immigrés et des Français par acquisition). On est encore loin des taux de ségrégation observés aux États-Unis, mais la mixité sociale s'effrite à mesure que les prix de l'immobilier s'envolent. |