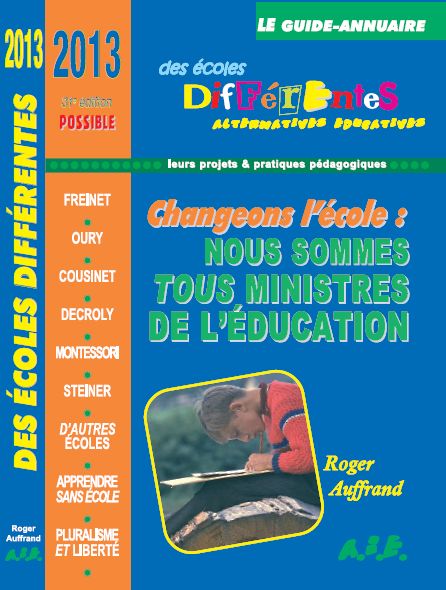«Un élève
qui ne comprend pas ce qu'il fait là»
EDUCATION - On les appelle les «décrocheurs»,
ceux qui quittent le système scolaire sans qualification. Ils seraient
10.000 dans l'académie de Lille. La Région a signé
une convention avec Martin Hirsch pour tenter de faire baisser leur nombre.
Qui sont les décrocheurs? Comment sortir de l'échec? Avec
Maryse Esterle-Hédibel, sociologue et maître de conférence
à l'IUFM de Lille, interview.
Qu'est-ce que le décrochage?
Un processus progressif. L'élève sort du système,
quelquefois sans être repéré dans la masse des élèves.
Ca peut avoir lieu sur des années : il est de moins en moins considéré
comme élève, par les enseignants, ses camarades, lui-même.
Il ne comprend pas ce qu'il fait là.
Est-ce que ça s'aggrave?
Non. Ils étaient 30% d'élèves en France dans les
années 70 à sortir du système sans aucune qualification,
18% au début des années 80, et 6% aujourd'hui.
Mais maintenant, on ne peut plus trouver du travail sans être
qualifié.
Oui. Les enseignants les plus âgés me disent : «Il
y a 30 ans, mes élèves étaient enfants d'ouvriers
du textile, maintenant, ils sont enfants de Rmistes». Il y a aussi
l'idée qu'un élève sans école est un enfant
dangereux. Or le décrochage ne conduit pas systématiquement
à la délinquance, loin de là. Ce qui est fréquent,
c'est la dépression à bas bruit. On s'isole, on reste devant
la télé. Dans le Nord, aussi, un gros risque de grossesses
adolescentes. Plusieurs fois j'ai croisé une mère de 30 ans,
avec sa fille de 15 ans, laquelle ne trouvait pas extravagant d'avoir un
enfant. Pour l'insertion professionnelle, les indicateurs sont au rouge.
Comment ça arrive, le décrochage?
C'est bien sûr multifactoriel, et différent selon les enfants.
Des problèmes d'apprentissage, qui traînent de classe en classe.
En sixième, cinquième, c'est l'effondrement. Dès le
départ, c'est une prise en charge pas adaptée. Tous les enseignants
ne savent pas traiter tous les problèmes, c'est normal, question
de formation. Là, les Rased on un rôle à jouer, en
tant que spécialistes. Ils ont une autre approche face à
des enfants qui ne comprennent pas, par exemple, à quoi ça
sert d'apprendre à lire, le sens de l'école.
Ce sont parfois des élèves perturbateurs.
Il peut y avoir des problèmes de souffrance à l'école,
parfois des problèmes avec l'autorité, avec les règles.
L'enfant qui va essayer de se faire reconnaître autrement que par
les performances scolaires va s'opposer, et c'est difficile à gérer
dans une classe. Les enseignants ont peu d'outils face à ça.
Ils considèrent que le rôle de l'élève, c'est
de savoir se tenir en classe, se comporter. L'enseignant dit : «si
tu te comportes bien, les conditions sont réunies pour que tu apprennes».
Or ce qui se passe en classe, c'est du javanais pour cet élève.
Il y a là un malentendu. On arrive en sixième avec des élèves
couverts de sanctions sans effet, et sans que leur niveau scolaire soit
pris en charge. On leur parle javanais, et on leur demande de se tenir
tranquille six à sept heures par jour. Face à ça,
les Rased
sont indispensables. Ils ne peuvent pas être remplacés par
l'aide personnalisée, deux heures par semaine, par des enseignants
pas formés. Les Rased
c'est une bonne prévention, et si le problème est pris à
temps, l'aide apportée peut être de courte durée.
Les Rased sont menacés, et l'Education nationale supprime
des postes.
C'est contradictoire. On agit d'un côté, et de l'autre,
on détricote. Les moyens ne sont pas tout, mais ça compte.
Si les Rased
ont moins d'effectifs, on aura beau faire toutes les réunions, on
tournera en rond. Quand les postes d'enseignants et de personnel para-scolaire
disparaissent, c'est moins de temps, moins d'écoute, et du coup
la tentation d'exclure, ou de laisser partir ceux qui dérangent.
Ceci dit, on ne peut que saluer cette idée nouvelle : on nous dit
que la lutte contre le décrochage est l'affaire de tous.
En plus des problèmes scolaires et disciplinaires, les problèmes
familiaux?
Il y a des ados qui décrochent parce qu'ils sont mobilisés
ailleurs. Certains sont soutiens de famille. Ils s'absentent pour protéger
leur mère frappée par leur père par exemple, ou pour
jouer un rôle de co-éducation des petits. Les services sociaux
s'occupent du plus urgent. On va s'occuper de protéger un enfant
maltraité. Mais une mère dépressive, alcoolique, pas
en mesure de suivre une scolarité, avec un enfant qui commence à
s'absenter, c'est peu repéré. Il n'y a pas forcément
d'assistante sociale dans tous les collèges, et si elle est là,
l'élève ne demandera pas forcément de l'aide. On va
s'occuper des ingérables, ou de ceux qui savent se faire aimer.
Je me souviens d'un élève qui avait repéré
que c'était au collège qu'il pourrait trouver une issue.
Il faut dire aussi qu'il y avait dans l'établissement un enseignant
connu des élèves comme "celui à qui on peut parler".
Il a tout de suite orienté vers une assistante sociale efficace.
Qu'est-ce qui marche?
Il n'y a pas de solution miracle. Ne pas se jeter sur la sanction. Il
faut du monde, il faut des heures, il faut des gens formés. Des
gens qui croient les gamins, qui n'ont pas un regard stigmatisant. Pour
ces élèves, la relation avec leurs profs est déterminante.
La logique empathique et le tutorat, ça marche mieux que les conseils
de discipline à répétition. Le travail en réseau.
Sinon, le meilleur système restera lettre morte.
Recueilli par Haydée Sabéran
Lire aussi :
Le
fond de la classe au premier rang
"L'école
et moi c'était pas top"
LE CONTEXTE - Le Nord-Pas-de-Calais et Centre vont expérimenter
des projets pour s'attaquer au décrochage scolaire et à favoriser
l'insertion professionnelle des jeunes, avec le Haut commissariat à
la Jeunesse. Ces thèmes figurent parmi les thèmes dominants
du Livre vert sur la jeunesse, rendu public par le Haut commissaire Martin
Hirsch.
Quelque 120.000 jeunes, selon le gouvernement, sortent chaque année
du système scolaire sans diplôme. Dans le Nord-Pas-de-Calais,
10.000 interrompent leurs études en cours de scolarité. Concernant
cette région, une convention d'objectifs pour la continuité
du parcours des jeunes a été signée le 8 juillet par
l'Etat et la région. Le montant du financement n'a pas été
précisé.On sait que des territoires, le Versant Nord-est
de la métropole lilloise, le bassin de la Sambre, l'ancien bassin
minier, le littoral, devraient être prioritaires.
La convention vise notamment à expérimenter des projets
pour mieux orienter et repérer des élèves qui risquent
de décrocher. Il s'agit par exemple de développer des écoles
de la deuxième chance, pour permettre de "réduire le nombre
de jeunes sans solution de formation ou d'emploi".
Pour la région Centre, le Fonds d'expérimentation pour
la jeunesse doit débloquer 961.000 euros sur 3 ans pour des projets
expérimentaux concernant le développement des dispositifs
d'alternance, le renforcement et la coordination des dispositifs d'orientation
et le repérage précoce des élèves en décrochage.
(Avec AFP)
A Vitry-sur-Seine, des classes
spécialisées proposent aux jeunes qui ont décroché
de renouer avec les études.
Par Véronique Soulé - Photos Jean-Michel
Sicot - Libération
- 24 12 09
«Pour vous expliquer comment faire un brouillon de dissertation,
nous allons prendre un sujet : y a-t-il une servitude volontaire ?»
commence le professeur de philo Jean Mouchard. Les huit lycéens
de terminale STG (sciences et technologies de la gestion) assis en face
de lui ont l’air assez découragé. Le cours est consacré
aujourd’hui à la méthodologie. Le sujet est austère
et les dissertations de philo font toujours un peu peur, particulièrement
à ces élèves du microlycée de Vitry-sur-Seine,
dans le Val-de-Marne, une structure qui accueille des jeunes décrocheurs.
Cet établissement entame sa deuxième année de fonctionnement.
Il est l’une des rares structures alternatives de l’enseignement public,
et aussi l’une des rares accueillant des jeunes déscolarisés
qui veulent reprendre des études et passer le bac. Ils sont 80 cette
année, âgés de 16 à 25 ans - mais il n’y a guère
plus d’une dizaine de mineurs -, répartis dans sept classes, une
seconde, trois premières et trois terminales : L (littéraire),
ES (économique et social) et STG option mercatique (commerce).
Echange
Dans quelques jours, les élèves ont un bac blanc et Jean
Mouchard les y prépare. «Vous allez voir, ce n’est pas si
compliqué. Il faut commencer par analyser les notions. Pour cela,
nous allons chercher des synonymes et des antonymes. Pour servitude, que
proposez-vous ?» Des bras se lèvent : «esclavage»,
«soumission»… «Des antonymes maintenant», enchaîne
le prof.«Liberté», «indépendance»…Les
élèves se sont pris au jeu. Jean Mouchard fait cours au gré
d’un échange permanent. «Connaissez-vous des situations de
servitude dans la vie ? demande-t-il. On entend dire parfois que l’amour-passion
en est une, ou la drogue, ou la croyance. Qu’en pensez-vous ?» Une
élève intervient sur l’amour fou «que l’on ne choisit
pas». Un autre sur la croyance, «une servitude, mais volontaire».
Un cours d’histoire-géographie se déroule dans la salle
voisine. Deux classes de terminale sont réunies, une vingtaine d’élèves
au total. Dans certaines disciplines - comme les langues ou l’éducation
physique et sportive -, les enseignants du microlycée font cours
par niveau. Cela leur permet de dégager des heures pour suivre individuellement
les élèves : chaque professeur est ainsi «tuteur»
de huit lycéens. Sujet du cours : «le retour à la tension
américano-soviétique : la "guerre fraîche" (1979-1985)»,
avec l’élection de Ronald Reagan, le boycott des Jeux olympiques
de Moscou, etc. L’atmosphère est plutôt bon enfant. Des élèves
ont apporté leur gobelet de café ou leur bouteille d’eau.
En début de cours, le professeur, Eric de Saint-Denis, l’un des
deux coordonnateurs du microlycée - avec Marie-Laure Gache, une
autre enseignante d’histoire-géo -, demande «qui est le preneur
de notes aujourd’hui» pour tenir à jour le cahier de textes
de la classe. Mina lève la main.
«Nous prenons des jeunes au parcours scolaire atypique, explique
Eric de Saint-Denis, un des fondateurs du premier microlycée, à
Sénart (Seine-et-Marne), où il est resté huit ans
avant de venir ouvrir le second à Vitry. Certains ont été
déscolarisés pendant plusieurs années. Ils ont connu
des situations de traverse à la suite d’accidents familiaux, de
déménagements mal acceptés, d’allers-retours entre
des pays ou encore de la naissance d’un enfant. Ce sont des jeunes qui
ne trouvent pas leur place. Le défi, pour nous, est de leur redonner
confiance, en eux et dans l’avenir, et de les aider à construire
un projet de formation.»
Pause
Le microlycée, soutenu par le recteur de Créteil - qui
a décidé d’en ouvrir un dans chaque département (Val-de-Marne,
Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis) de l’académie -, est installé
au sein du lycée Jean-Macé. 200 mètres carrés,
au premier étage d’un bâtiment : six salles refaites à
neuf le long d’un couloir et, au milieu, la salle commune. C’est ici que
se retrouvent élèves et enseignants pour discuter, manger,
regarder le courrier dans leurs casiers, consulter les emplois du temps,
etc. «C’est le cœur, le poumon de l’établissement»,
précise Eric de Saint-Denis.
Pour s’inscrire, il faut avoir un niveau de fin de troisième
et de sérieuses motivations. Beaucoup reprennent en effet après
un, deux, voire trois ans de «pause» où ils ont fait
des petits boulots, déprimé ou se sont simplement amusés.
Dans l’idéal, l’objectif est de leur faire décrocher le bac,
même si l’équipe refuse d’en faire une obsession.
Certains jeunes, malgré une bonne volonté initiale, se
remettent vite à sécher. Marion, 21 ans, en terminale STG,
une grande fille un peu timide, croyait ne plus jamais retourner en classe.
«J’ai raté deux fois le bac, j’avais des problèmes
personnels et autres, explique-t-elle. Ça m’aurait pris la tête
de recommencer dans un établissement scolaire classique. Je pensais
le repasser en candidate libre.» Mais durant un an, Marion s’occupe
de ses grands-parents et ne peut plus étudier. Coup de chance :
un jour, sa mère tombe sur un article sur le microlycée.
Il y est précisé que les candidats doivent téléphoner
eux-mêmes. Marion appelle, puis se rend à l’entretien individuel.
Le contact lui plaît, plus humain, plus chaleureux que dans une école
«normale». «J’ai toujours eu des problèmes scolaires,
dit-elle. J’étais tout le temps sur le carreau, de la part des élèves
comme des profs. J’étais comme transparente.» Dans cette petite
structure un peu familiale, elle se sent exister. «Maintenant, j’espère
avoir le bac, dit-elle. Je voudrais être assistante sociale ou psychologue,
j’y pense depuis des années. Je me vois travailler d’abord à
l’hôpital, puis dans un centre gériatrique car j’ai un bon
contact avec les personnes âgées. Mais avant, quand j’en parlais,
les profs me disaient : tu n’y arriveras jamais, au mieux tu seras aide-soignante.
A force de dire que vous êtes nulle, on finit par le croire.»
Injustice
A ses côtés, habillée tout en noir et l’air décidé,
Bernadette, 20 ans, en terminale ES. Elle est encore révoltée
par l’injustice qu’elle a subie. En juin 2008, elle rate son bac au lycée
Jean-Jaurès de Montreuil (Seine-Saint-Denis). Elle veut redoubler
mais se voit répondre qu’il n’y a plus de place. «J’étais
vraiment outrée, explique-t-elle. J’avais des amis qui avaient redoublé,
pourquoi pas moi ?» Elle fait le tour des lycées de la région,
est reçue dans les couloirs, insiste… En vain. «J’ai eu alors
de gros problèmes familiaux et mon rôle à la maison
s’est intensifié», dit-elle. Bernadette a perdu sa mère,
guadeloupéenne, lorsqu’elle avait 8 ans. Son père, haïtien,
s’est retrouvé seul avec quatre enfants. Il prend une retraite anticipée
et ne touche que 400 euros par mois. Bernadette s’occupe de la maison,
où l’on ne chauffe plus. Majeure, elle doit aussi se faire faire
des papiers français. «Au moins, tout ça m’a renforcée»,
dit-elle. Aujourd’hui régularisée, elle envisage de travailler
à temps partiel chez McDo pour aider son père. «J’arriverai
à faire les deux, je suis une fille organisée.» Elle
voudrait aussi s’occuper de son petit frère qui a décroché
et se retrouve en quatrième Segpa (classe pour les élèves
en très grosse difficulté) : «Ça m’attriste,
dit-elle. J’ai parlé avec ses profs pour voir comment le raccrocher.»
Présence
Beaucoup, au microlycée, ont été victimes d’une
mauvaise orientation, comme Nasser, 18 ans, en première ES. Il a
redoublé sa troisième et a été dirigé
vers un BEP électronique. Mais il a vite lâché et a
pris «une année sabbatique pour faire la fête…»
Aujourd’hui, Nasser, qui se présente comme «le cancre de sa
famille», veut devenir architecte.
Johana, 18 ans, en première L, a redoublé sa seconde.
«J’avais des problèmes de comportement, je n’ai jamais aimé
l’autorité.» Elle a alors été orientée
en première bac pro pour faire de la comptabilité, de la
vente, etc. «Je dormais en cours, j’ai fini par me barrer. Ma mère
me disait : "Tu es tellement nulle que même en pro, ça ne
marche pas."» Or, Johana rêve d’être interprète.
Elle parle anglais, néerlandais et se débrouille en espagnol
et en italien. «Depuis toute petite, ma mère m’envoie dans
une famille d’accueil aux Pays-Bas pour passer mes vacances d’été
et d’hiver. J’ai beaucoup voyagé avec cette famille, appris des
langues.» Mais «pessimiste de nature», Johana doute encore
d’elle-même : «L’autre jour, j’ai demandé à mon
prof s’il notait normalement, il m’a dit que oui.»
Pour les enseignants, travailler dans cette structure est un véritable
engagement. Tous - huit temps plein, quatre mi-temps, la plupart venant
de Jean-Macé - sont volontaires. Certifiés ou agrégés,
ils sont payés comme dans le public «classique». Mais
au microlycée, on ne parle pas de «temps de service»
- dix-huit heures d’enseignement par semaine pour les certifiés,
quinze pour les agrégés. Ici, les enseignants font trente
heures de présence, du lundi au vendredi, dont quatorze heures de
cours. Le reste du temps, ils ne chôment pas. Ils assurent la permanence
téléphonique - il n’y a pas de personnel administratif ni
de surveillant -, font à tour de rôle le ménage de
la salle commune avec les élèves, participent aux réunions
du mardi après-midi, assurent du tutorat, animent avec un intervenant
l’un des cinq «ateliers de pratiques culturelles» - slam, yoga,
presse, théâtre en espagnol et découverte des arts
-, etc. «Il faut avoir le goût du travail en équipe,
souligne l’un d’eux. Les élèves sont intéressants
et les classes peu chargées, mais c’est très prenant.»
Ce mardi, la réunion commence par le cas d’un lycéen absentéiste.
Comment le remotiver ? Suit la demande d’une élève qui voudrait
passer de STG à ES pour faire une école de marketing. «Ne
vaut-il pas mieux un bon bac STG qu’un bac ES trop juste ?» se demande
un prof. La nuit tombe. La réunion continue. Les élèves
sont presque tous repartis chez eux. Les profs veillent encore.
A R C H I V E S
Education
Ecole sans issue pour élèves
hors-circuit
lundi 04 octobre 2004 -
Liberation
C'est une histoire de révolte, de découragement
et d'impuissance combinés. Elle toucherait 1 % de la population
du collège, soit 32 500 élèves qui, pour diverses
raisons, sont déscolarisés. Au total, 160 000 élèves
sortiraient chaque année du système éducatif sans
aucune qualification, selon les plus récentes évaluations
de l'Education nationale. Là commence le trompe-l'oeil. Car cette
histoire se raconte sous le titre générique de «déscolarisation»
alors qu'à écouter les acteurs de terrain comme à
lire les chercheurs, le mot ne souffre que le pluriel.
C'est ce que nous voyons à Montreuil (lire page 6), dans ce département
de Seine-Saint-Denis où se joue en cette rentrée un des ratés
les plus ahurissants de l'Education nationale: 2000 élèves,
sortant de collège, se sont retrouvés sans affectation. Comme
un bras d'honneur que l'institution aurait autoadministré à
tous ses discours sur l'équité du système, des élèves
le plus souvent issus de catégories défavorisées et
qui s'étaient vu reconnaître le niveau pour entrer au lycée
ont été contraints au redoublement, faute de places, essentiellement
en lycée professionnel. Faute aussi de prévisions assez fines
des chefs d'établissement. C'est le cas à Grigny (lire page
5), où les professionnels de la jeunesse héritent d'autant
de cas particuliers qu'il y a de jeunes déscolarisés.
Rupture. C'est ce que décrit cette vaste enquête
sociologique commandée il y a cinq ans, enfouie dans les tiroirs
ministériels, qui sort enfin en librairie (lire page 5), et qui
souligne l'hétérogénéité des processus
qui mènent à la déscolarisation «Avant
tout un symptôme qui ne parle pas seulement de l'école, mais
surtout des familles et des trajectoires des individus», disait déjà
le sociologue Hugues Lagrange en 2001, suite à une étude
sur la déscolarisation dans le Mantois (Libération du 30
janvier 2001). L'enquête souligne également qu'aucun milieu
n'est protégé. Aux côtés des enfants du voyage,
des primo-arrivants ou des gamins confrontés à des contextes
familiaux en miettes, des enfants issus de milieux favorisés sortent
aussi du système un livre paru l'an passé décrivait
avec finesse ces processus de rupture affectant des fils et filles d'enseignants,
d'artistes ou de cadres supérieurs (1).
Sanctions. Dès son arrivée, le gouvernement Raffarin
avait empoigné le sujet. Les parents d'enfants déscolarisés
seraient exposés à une sanction pénale et à
une contravention pouvant aller jusqu'à 750 euros. Il avait également
enrichi les dispositifs de raccrochage existants, créant aux côtés
des «classes-relais» des «ateliers-relais» dont
le bilan reste mitigé. François Fillon a repris le flambeau,
indiquant vendredi à Poitiers que «l'horizon» qu'il
souhaite fixer à l'école est «celui de 100 % d'élèves
obtenant une qualification», comme la loi d'orientation Jospin de
1989, mais en renonçant au besoin à l'objectif «80
% d'une classe d'âge au niveau bac».
Ça tombe bien. Les sondages réalisés par
les syndicats enseignants montrent que les professeurs n'y croient plus
; d'ailleurs la machine a calé voici dix ans à 65 %. Reste
à savoir comment une institution habituée à gérer
des flux normalisés saura résoudre un phénomène
qui appelle à l'évidence des réponses en dentelle,
adaptées au cas de chaque enfant ou adolescent, prenant en compte
les implications respectives des familles, de l'école et de l'environnement
social. Seule certitude : persister à ne répondre à
la question de l'échec scolaire que par l'orientation en lycée
professionnel, comme le fait depuis deux ans et demi le gouvernement Raffarin,
ne marchera pas mieux demain qu'hier.
(1) Décrocheurs d'école, Gilbert Longhi et Nathalie
Guibert, éditions La Martinière.
Education. Editorial
Décrochages
lundi 04 octobre 2004 - Liberation
Naguère, on voulait amener 80% d'une classe d'âge au baccalauréat,
voilà que le ministre de l'Education reprend l'objectif de 100%
d'élèves obtenant une qualification. Pourtant, l'échec
relatif de la précédente ambition aurait dû
conduire à modérer cette exaltation statistique. La progression
inquiétante des «déscolarisations», un mot qui,
dans le contexte, suggère la délocalisation d'un enfant hors
de l'école, devrait inciter à se fixer une autre contrainte,
qui serait: 100% d'imagination pour résoudre 1% de cas apparemment
désespérés de jeunes que le système exclut
et qui s'en excluent en retour. Avec un tel slogan, on ne bat pas la campagne
électorale. Mieux vaut faire de l'absentéisme scolaire une
grande cause sécuritaire en rendant les parents responsables pénalement
de cette « école de la rue» comme on disait avant, où
se formeraient les «sauvageons» comme on dit maintenant.
Evidemment, quand on y regarde plus près, quand on rentre dans
le détail des décrochages de ces jeunes, ce n'est pas l'affaire
des institutions répressives, mais en premier lieu celle de l'institution
scolaire elle-même. Non qu'il s'agisse de lui reprocher de ne pas
garantir la réussite de tous, ni encore de sanctionner les comportements
insupportables, mais elle est rarement capable d'assumer le suivi des échecs
qu'elle sécrète. Il n'est pas surprenant que les services
sociaux communaux se retrouvent alors avec ces enfants largués sur
les bras et que des enseignants soient les premiers indignés du
manquement de leur administration à ses missions. Des solutions
existent pourtant, depuis les classes et collèges relais jusqu'aux
centres de formations des chambres de commerce et d'industrie, en passant
par des évaluations individuelles qui n'écrabouillent pas
les «projets» personnels dans des logiques de flux ou de relégations.
Bref, il faut mettre l'innovation au pouvoir: ce n'est pas l'air du temps
à l'Education nationale.
Education
SOS Rentrée repêche
les déscolarisés
lundi 04 octobre 2004 - Liberation
«Je suis fatigué d'aller mendier pour que les gamins puissent
aller à l'école; je suis fatigué que l'on mente au
gosse en lui disant: "Quand tu auras ton BEP, tu iras plus loin."»
Il
y a des jours comme ça où Amar Henni (1) a besoin de pousser
des coups de gueule. Surtout aux alentours de septembre. Tous les ans,
c'est un peu la même histoire qui se joue dans le bureau du directeur
du service jeunesse de la ville de Grigny, où se trouve la plus
grande cité de l'Essonne, la Grande Borne. Dans les jours qui suivent
la rentrée scolaire, il voit débarquer «les gamins
sans école». Aujourd'hui, il y a Karim (2), 14 ans, exclu
de son collège après une bagarre ; Gelloul, titulaire d'un
BEP ventes à la recherche d'un bac pro ; Mamadou en liste d'attente
pour un bac électrotechnique après un BEP ; Pierre, 22 ans,
qui recherche désespérément une entreprise pour préparer
une licence en alternance après un BTS d'informatique industrielle.
Il y a aussi Eric, qui dit en riant : «Maintenant que j'ai fait
le tour de tout, je voudrais réapprendre.»
Forcing de l'académie. «Entre le cas quasi pathologique,
le moyen et le bon élève, nous sommes confrontés à
un très large panel de situations», explique Laurence
Legagneux, éducatrice. SOS Rentrée est né, il y a
cinq ans, quand cinq gamins ont sollicité l'aide d'Amar Henni et
de son équipe. «On a placé tous les gosses dans
des établissements», se souvient-il. Depuis, SOS Rentrée
s'inscrit dans un dispositif plus officiel de veille éducative mis
en place par la ville de Grigny. En 2000, 40 jeunes sont venus frapper
à la porte de SOS Rentrée. Ils étaient 64 en 2001
; 65 en 2002, 59 en 2003. «Cette année, on va exploser
les chiffres, pronostique un éducateur. Et il y a tous ceux qu'on
ne voit pas car ils ne viennent pas à nous.» L'efficacité
de SOS Rentrée tient à cette subtile alchimie relationnelle
qui mêle la confiance des familles des cités, les liens informels
tissés avec les chefs d'établissement, les enseignants et
«la bonne volonté» des institutions. «Il faut
le souligner: l'académie fait aussi le forcing pour nous aider à
trouver une solution pour les gosses», explique Laurence Legagneux.
Ce matin, Karim roule gentiment les mécaniques dans son blouson
tout neuf. «Il vient nous voir tous les jours, raconte Marcel, un
éducateur. Au début, il demandait s'il pouvait rester près
de nous.» Karim dit : «Venir ici, ça comble un vide.»
«C'est un gamin indiscipliné, mais il a de bonnes notes»,
affirme Amar Henni. Karim a attendu tout l'été pour passer
devant le conseil de discipline de son collège à la fin du
mois d'août. «Je pensais qu'ils allaient me garder»,
murmure-t-il. «Toi, tu ne comprends rien à la vie»,
souffle un jeune. Depuis trois semaines, Karim attend de connaître
le nom de son nouveau collège. «Il nous tanne tous les jours
pour qu'on appelle l'inspection académique, dit un éducateur.
Pour ces jeunes, être exclu de l'école c'est être considéré
comme une victime. C'est être quelqu'un de faible que tout le monde
peut humilier. Les gamins ne veulent pas être jugés comme
des victimes.» Selon Laurence Legagneux, les jeunes ont une double
perception de l'école: «Ils éprouvent du dégoût
quand elle les exclut, mais, en même temps, ils reconnaissent que
c'est leur planche de salut.»
Liste d'attente. Il n'y a pas pire réputation, explique
un adolescent, que d'être dans la rue quand les autres sont à
école. Farid, 18 ans, a décroché en juin un diplôme
d'électricien, mais il a toujours voulu apprendre la mécanique
auto. Il est sur liste d'attente et part tous les jours de chez lui comme
s'il allait en cours. «Il m'a dit : "Si mon père sait que
je n'ai plus d'école, il va me foutre dehors"», explique
un éducateur. «L'école, c'est l'éducation.
L'éducation, c'est le modèle. Si tu n'as pas le bon modèle,
tu prends le mauvais exemple», affirme Eric. Il a connu lui aussi
l'exclusion disciplinaire, le changement d'établissement et, à
la clé, de nouveaux ennuis. «Je me suis retrouvé
tout seul dans un collège où des mecs avaient des embrouilles
avec ma cité. J'ai "pris" pour les autres.» Eric ajoute
en regardant Karim : «Ce petit, il faut qu'il aille à l'école
dans sa ville.» Il n'est cependant pas toujours facile de trouver
un établissement pour un élève exclu dans le cadre
d'une procédure disciplinaire. Amar Henni le reconnaît :
«On me dit : "Pourquoi je prendrais un gamin qui fout le bordel alors
que j'ai un candidat qui a 14/20 de moyenne ?"» Karim devra s'engager
«en donnant sa parole» dans le cadre d'un «contrat de
confiance» avec le principal de son nouveau collège.
Le piston qui manque. Pierre, 22 ans, n'avait pas connu de difficultés
scolaires avant d'être bloqué à l'entrée de
sa licence, faute d'employeur pour sa formation en alternance. Il a démarché
«une centaine d'entreprises dans le 91, le 92 et le 77» : «Soit,
elles n'ont pas de besoin, soit je ne corresponds pas à leur attente,
soit elles ont déjà un stagiaire. Je crois que c'est le piston
qui me manque.» Pierre joint les deux bouts en faisant le manutentionnaire
et tient «ses connaissances à jour avec l'Internet et des
revues». Il dit : «Au point où j'en suis, je serais
prêt à aller travailler.» Le découragement
pointe aussi chez Gelloul, 17 ans. Avec son BEP ventes «14,5
de moyenne» , il était admis en première d'adaptation
STT commerce en Seine-Saint-Denis. «Mais ma famille a dû
déménager en Essonne, où je me suis retrouvé
en première de gestion. On m'a dit: "C'est ça ou rien." Mais
la gestion, c'est du chinois pour moi.» Après un mois de cours,
Gelloul «ne sait plus où il en est et voudrait faire un bac
pro vente».
Pour Laurence Legagneux, les obstacles rencontrés par les aînés
ne facilitent pas la scolarisation des plus jeunes : «Comment
leur dire que c'est indispensable d'aller à l'école quand
ils voient que les plus grands à BAC + 5 ne disposent pas du bon
réseau pour trouver du boulot ou un stage ?» Quelques
heures plus tard, l'éducatrice a retrouvé le sourire: elle
vient d'apprendre que Karim irait au collège ce lundi et, surtout,
elle a déniché une place en mécanique auto pour Farid
: «Je suis contente, j'ai fait un heureux.»
(1) Amar Henni est l'auteur avec Gilles Marinet des Cités
hors la loi, Editions Ramsay, 2002.
(2) Les prénoms ont été modifiés à
la demande des jeunes.
Education.
Dominique Glassman, l'un des directeurs de la longue étude
commencée en 1999:
«Perçu comme un
chômeur juvénile»
lundi 04 octobre 2004 - Liberation
Les situations de décrochage ont fait l'objet d'une longue
étude, engagée en 1999, à laquelle une vingtaine de
sociologues ont participé. Estimant que la déscolarisation
est un processus social, ils se sont concentrés sur les jeunes des
quartiers populaires, scolarisés en ZEP.
Cette somme de recherches, menées au sein d'un programme
interministériel, vient d'être publiée sous le titre
la
Déscolarisation (1).
Entretien avec Dominique Glasman, l'un des directeurs de l'étude.
Comment expliquer que des élèves ne trouvent pas leur
place à l'école?
Les processus de déscolarisation sont complexes. Ce qui se passe
dans la famille, à l'école ou dans le quartier, est profondément
imbriqué. On constate que des élèves de milieux populaires
sont progressivement satellisés de l'école ou du collège,
puis évacués. Ils n'ont pas disposé du soutien nécessaire
pour mener à bien leur scolarité, ni dans leur entourage
familial, ni dans l'école. On parle trop facilement de «démission
des parents»; il s'agit plus sûrement de désarroi. Un
jeune sorti de l'école avant 16 ans interroge tout autant l'institution
scolaire. Parfois, le jeune n'y a tout simplement pas de place: pas d'établissement
où s'inscrire, ou bien on l'oriente dans une filière qu'il
refuse. Il arrive aussi que le jeune ne trouve pas sa place à l'école,
qui reste à ses yeux un lieu étrange, illisible, où
il ne se sent pas bien, dont il ne saisit pas le sens.
Reste qu'être élève confère un statut social.
Sans l'école, peut-on vraiment s'intégrer ?
Il est vrai qu'aujourd'hui, l'enfant ou l'adolescent qui ne bénéficie
pas du statut d'écolier, de collégien ou de lycéen,
est hors norme, marginalisé. Cela inquiète d'autant plus
que l'instance de socialisation qu'a été le monde du travail
ne joue plus ce rôle pour eux. L'école est devenue l'instance
majeure de socialisation des jeunes. Mais quand on se sent disqualifié
par l'institution scolaire, on a tendance à la disqualifier à
son tour, pour surmonter l'épreuve et retrouver une confiance en
soi. C'est le comportement d'élèves qui, ne voulant pas passer
pour des nuls, refusent tout nettement de travailler quand ils commencent
à perdre pied. En refusant l'école, en la tenant à
l'écart, peut-être juste un temps, ces élèves
retrouvent une forme de confiance en eux.
Ces situations sont-elles irréversibles?
Des dispositifs de rescolarisation existent, dans l'école ou
sa périphérie. Notre société est certes marquée
par l'hégémonie de l'école et du diplôme, mais
les jeunes doivent pouvoir y accéder, même s'ils ont un temps
rompu les amarres. On peut également admettre que certains jeunes
trouvent leur place en dehors de l'école. C'est le cas pour ceux
qui peuvent travailler dans le commerce familial; trouver une identité
au sein de leur groupe social ou culturel comme chez les gitans; se resocialiser
dans leur quartier. Mais la déscolarisation inquiète: un
jeune qui n'est pas à l'école est perçu comme un chômeur
juvénile par les élus, un sauvageon prêt à se
livrer à des actes de délinquance. En réalité,
les décrocheurs devenus délinquants n'avaient pas forcément
attendu d'être hors de l'école pour commettre des délits.
Il n'empêche, la déscolarisation révèle une
émotion autour des classes sociales «dangereuses». Ce
n'est pas par hasard que Nicolas Sarkozy a pris en main la question de
l'absentéisme. Un jeune qui a abandonné l'école, ou
que l'école a abandonné, est considéré comme
désocialisé et donc «à risque». Voilà
pourquoi ce problème est devenu une question publique, qu'il y a
mobilisation pour rescolariser ces élèves ou éviter
que s'enclenche le processus.
(1) Aux éditions La Dispute, août 2004.
Education
L'exclusion scolaire, une punition
aussi pour les profs
lundi 04 octobre 2004 - Liberation
« Ce sont des élèves qui se retrouvent «sur
le carreau», sans établissement pour les accueillir, et
des professeurs furieux. «A la fin de la 3e, les élèves
font un choix. L'institution ne peut répondre à leur choix.
Toute l'année, on les aide, on bâtit un projet avec eux, on
fait un travail d'accompagnement. Tout ça pour ce résultat:
on se fiche aussi de nous.» Marie Karaquillo est enseignante
de sciences et vie de la terre au collège Fabien à Montreuil
(Seine-Saint-Denis). A la rentrée, vingt élèves (soit
deux élèves par classe) n'avaient pas trouvé d'établissement.
«Cette
année, c'est la première fois qu'on en a autant»,
reconnaît une cadre du collège qui tient à rester anonyme.
Aujourd'hui, elle assure que des solutions ont été trouvées,
sauf pour trois d'entre eux.
Bidouillage. Mais quelles solutions? Six se sont vu proposer
un redoublement. Pour certains, les résultats ne le justifiaient
pas. «Les autres ont été recasés par l'équipe
de direction, mais dans des voeux qui ne correspondent pas toujours à
ce qu'ils avaient demandé en priorité», explique
un prof d'EPS. Les professeurs parlent de «bidouillage», racontent
que des coups de fil ont été passés dans les centres
de formation d'apprentis pour voir s'il y avait de la place.
Notre cadre anonyme tient un discours plus nuancé: «On
n'a pas eu d'élèves parachutés sur ce qu'ils n'avaient
pas demandé. Il y a aussi des dénouements heureux»,
affirme-t-elle, optimiste, avant, toutefois, de reconnaître : «Il
y a un réel problème par rapport à l'affectation.
On ne peut pas se satisfaire de cela et bien le vivre. On est vraiment
dans un paradoxe. L'élève demande une formation et ne l'obtient
pas. Ce n'est pas facile de l'expliquer aux élèves.»
Avant de conclure: «Le problème global, c'est qu'il y a
de plus en plus d'avis d'orientation pour le lycée professionnel
et qu'il n'y a pas de places pour le lycée professionnel.»
Sale boulot. Plus loin, cette cadre parle du manque de maturité
des élèves. Ils ne sont pas toujours sûrs de ces choix
faits à 15 ans. Ils s'avouent parfois déçus après
quelques semaines de leurs propres orientations. «Ce n'est pas
parce qu'un élève aura obtenu ce qu'il souhaite qu'il sera
satisfait de ce qu'il a.» Même si certains choisissent
«au hasard» telle spécialité parce que c'est
l'établissement le plus proche de chez eux qui la propose. Pourtant,
des professeurs ont quand même le sentiment de faire le «sale
boulot», comme dit Antoine, prof d'EPS. On leur laisse le soin
d'annoncer qu'ils n'ont pas vraiment le choix, en fait.
«Au moment de l'orientation, on leur dit de ne pas mettre qu'un
voeu. On suggère de mettre secrétariat à celles qui
veulent faire sanitaire et social.» Parce que cette filière
est trop demandée. Le sale boulot, c'est aussi de ne pas masquer
aux élèves leurs incapacités, sans pour autant se
tromper sur leurs aptitudes à progresser. «Ceux qui veulent
être vétérinaires, on ne va pas les décourager
tout de suite, alors on envisage quelque chose "autour" du cabinet de vétérinaire.»
Les enseignants trouvent que ces difficultés à trouver
un établissement adéquat accroissent le malentendu vis-à-vis
des familles, qui ont l'impression de subir le système scolaire.
N'empêche, d'autres le vivent plus mal encore. Sans le dire. «Cet
échec, on le prend pour nous», dit une prof qui raconte comment
une de ses collègues lui a lâché, comme pour se protéger:
«Mes élèves? Je ne veux pas entendre parler de ce qu'ils
sont devenus.»
Education
A savoir
lundi 04 octobre 2004 - Liberation
1% des 3,25 millions de collégiens que compte la France seraient
déscolarisés. Ce phénomène s'opère le
plus souvent entre 14 et 16 ans. Les filles sont presque autant concernées
que les garçons.
« S'il m'était permis de fixer un autre horizon, je fixerais
un objectif plus large, pas moins réaliste ni moins ambitieux, celui
des 100% d'élèves obtenant une qualification.» François
Fillon, ministre de l'Education nationale, le 1er octobre à Poitiers
16 ans
En France, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge
de 16 ans. Depuis 1989, une circulaire du ministère de l'Education
nationale précise que «nul ne doit sortir de l'école
sans qualification».
Absences
5% des élèves du second degré sont absents plus
de quatre demi-journées par mois. La moitié des collèges
et lycées ayant participé à l'enquête «la
Déscolarisation» comptabilisent 2 % d'élèves
absentéistes, mais un sur dix en enregistre 15 %.
Le décrochage scolaire, qui désigne les jeunes en voie
de déscolarisation, touche 8% d'une classe d'âge, soit 60
000 jeunes par an en France, selon une étude de l'Education nationale
en 2001.