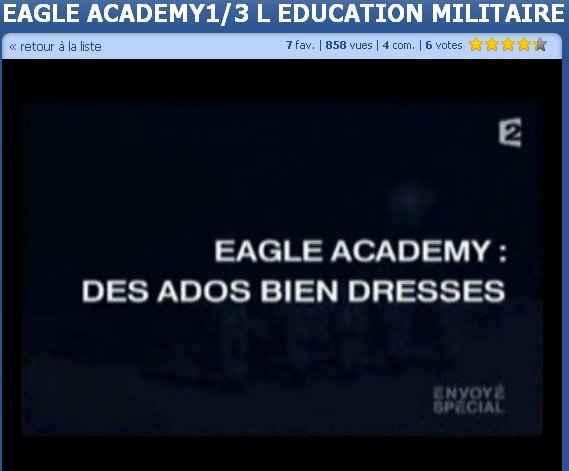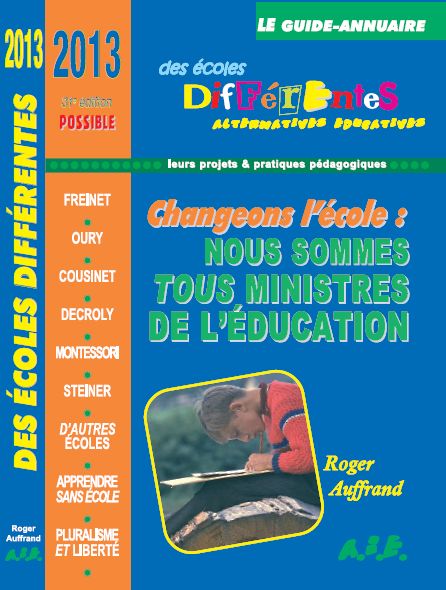Archives
(1978)

n°
13 - avril 1978 - 49 fr
Alors,
on n'a pas école aujourd'hui?
Faire bouger Goliath,
par
Henry Dougier 
Ces pratiques
alternatives: un modèle?
Des
« lieux pour enfants » où s'inventent d'autres rapports,
par
Catherine Baker, Jules Chancel
Cinq expériences,
cinq itinéraires
-
La Barque, comme le nom l'indique
-
Le Toboggan, avant la chute ... ailleurs
-
Le Moulin des souvenirs
-
L'Ecole en Bateau à contre-courants
-
Le projet Jonas,
Jonas-en-Corrèze
: un réseau
D'autres lieux
Mais
qui, diable, va dans ces «écoles» et pourquoi ?
par
Catherine Baker
-
La Roulotte
-
L'Ecole et la Ville
-
Le groupe de Houilles-Argenteuil
-
Terrevigne en Beaujolais
-
Belbezet
-
Le Har
-
La Commune
-
L'A.C.C.E.N.
Critiques et
réponses
Attaques
... et hésitations ...
Parades
... et auto-critiques
Deux
bilans :
«
Attention Ecole », 73-74
«
La Mosaïque », 75-76
Une «
théorie»
par
Jules Chancel
Où
il n'est plus question de cheveux blonds ni de sourires panoramiques ...
mais de politique!
Face
à face, l'enfant et l'adulte
Confrontations
Plusieurs
silences bien gênants ! (Guy Avanzini)
Je
demande toujours : quoi de neuf ? (Fernand Oury)
Prendre
la tangente
(Fernand
Deligny)
Une
alternative? Non, une reproduction du système scolaire (Etienne
Verne)
La
longue marche des innovateurs (Louis Legrand)
Vitruve,
une école perpendiculaire ... (L'équipe de la rue
Vitruve)
Le
lieu central de lutte, c'est l'école publique !
(Jacques
Guyard)
Comment
enclencher sur le milieu populaire ? (Bernard Defrance, Louis Caul-Futy)
«
L'initiation » plutôt que la pédagogie (René
Schérer)
Ecoles
parallèles ... Lieux de vie ... Réseaux
(Liane Mazère)
BRITISH
WAY OF LIFE
Le "modèle"
anglo-saxon, libéral ... et blairo-socialiste...
 En dix ans, le nombre d’enseignants en Angleterre a augmenté de
10% tandis que celui
des assistants (non qualifiés, et 3 fois moins payés)
a triplé .
En dix ans, le nombre d’enseignants en Angleterre a augmenté de
10% tandis que celui
des assistants (non qualifiés, et 3 fois moins payés)
a triplé .
 ÉCOLES
ANGLAISES : ÉCOLES
ANGLAISES :
Discipline, rigueur et esprit
compétitif sont les maîtres mots de la mutation mise en œuvre
par le gouvernement travailliste..
 Royaume-Uni
: L’uniforme discriminatoire Royaume-Uni
: L’uniforme discriminatoire
En imposant un fournisseur
unique pour l’achat de l’uniforme, les écoles pratiquent une discrimination
à l’encontre des élèves pauvres.
 Directeur
d'école en Grande Bretagne : Directeur
d'école en Grande Bretagne :
« Le métier
a beaucoup évolué. Aujourd’hui, on est beaucoup plus responsable,
on a plus de pression,
on nous demande plus de résultats. »
 Deux
fois plus d’enseignants sont partis en retraite
anticipée au cours des sept dernières années. Deux
fois plus d’enseignants sont partis en retraite
anticipée au cours des sept dernières années.
 35%
des élèves de 11 ans ne savent pas lire. 35%
des élèves de 11 ans ne savent pas lire.
 Un
ado sur cinq ne peut situer son pays sur une carte. Un
ado sur cinq ne peut situer son pays sur une carte.
 Ecoles
publiques fermées aux pauvres. Un rapport émis
par ConfEd, (une association qui représente les dirigeants
du secteur de l’éducation locale) dénonce le manque d’intégrité
des processus d’admission dans certaines écoles publiques. Des réunions
de "sélection" d’élèves sont organisées, durant
lesquelles ne sont admis que les enfants "gentils, brillants et riches".
Ainsi, 70 000 parents n’ont pas pu inscrire cette année leurs enfants
dans l’école de leur choix. En écartant les élèves
issus de milieux pauvres, ces établissements "hors la loi" espèrent
rehausser leur taux de réussite aux examens. Ecoles
publiques fermées aux pauvres. Un rapport émis
par ConfEd, (une association qui représente les dirigeants
du secteur de l’éducation locale) dénonce le manque d’intégrité
des processus d’admission dans certaines écoles publiques. Des réunions
de "sélection" d’élèves sont organisées, durant
lesquelles ne sont admis que les enfants "gentils, brillants et riches".
Ainsi, 70 000 parents n’ont pas pu inscrire cette année leurs enfants
dans l’école de leur choix. En écartant les élèves
issus de milieux pauvres, ces établissements "hors la loi" espèrent
rehausser leur taux de réussite aux examens.
 Selon
l'OCDE, les écoles privées britanniques ont les meilleurs
résultats au monde :
FAUX ! Selon
l'OCDE, les écoles privées britanniques ont les meilleurs
résultats au monde :
FAUX !
 ...
& Moins de pauvres dans les écoles primaires catholiques. ...
& Moins de pauvres dans les écoles primaires catholiques.
 Les
écoles anglaises pourront être gérées par des
"trusts". Les
écoles anglaises pourront être gérées par des
"trusts".
 L’école
britannique livrée au patronat. En mars 2000, le Conseil
européen de Lisbonne avait fixé comme principal objectif
à la politique de l’Union en matière d’éducation de
produire un capital humain rentable au service de la compétitivité
économique. L’école
britannique livrée au patronat. En mars 2000, le Conseil
européen de Lisbonne avait fixé comme principal objectif
à la politique de l’Union en matière d’éducation de
produire un capital humain rentable au service de la compétitivité
économique.
 Le
créationnisme aux examens. Le
créationnisme aux examens.
 "BAGUE
DE VIRGINITE" : Une
adolescente anglaise, fille d'un pasteur
évangélique, perd son procès en Haute Cour. "BAGUE
DE VIRGINITE" : Une
adolescente anglaise, fille d'un pasteur
évangélique, perd son procès en Haute Cour.
 Grande-Bretagne
:
l'athéisme (bientôt ?) au programme scolaire Grande-Bretagne
:
l'athéisme (bientôt ?) au programme scolaire
 Grande-Bretagne
:Les
sponsors au secours de l'école Grande-Bretagne
:Les
sponsors au secours de l'école
 Empreintes
digitales pour les enfants d'une école de Londres. Le Royaume-Uni
réfléchit à la mise en place d’une loi pour la création
d’un fichier national des enfants de moins de douze ans. Empreintes
digitales pour les enfants d'une école de Londres. Le Royaume-Uni
réfléchit à la mise en place d’une loi pour la création
d’un fichier national des enfants de moins de douze ans.
 Naître
et grandir pauvre en Grande-Bretagne est encore plus pénalisant
que dans d’autres pays développés. Naître
et grandir pauvre en Grande-Bretagne est encore plus pénalisant
que dans d’autres pays développés.
 Un demi-million de «sans-logement». A
Londres, un enfant sur deux sous le seuil de pauvreté.
Un demi-million de «sans-logement». A
Londres, un enfant sur deux sous le seuil de pauvreté.
 Un
demi-million d'enfants britanniques travaillent "illégalement". Un
demi-million d'enfants britanniques travaillent "illégalement".
 «tolérance
zéro» et conditions de détention intolérables.
Plus
de dix milles jeunes délinquants britanniques sont emprisonnés.
«Le bilan du Royaume-Uni en terme d'emprisonnement des enfants est
l'un des pires qui se puisse trouver en Europe.» «tolérance
zéro» et conditions de détention intolérables.
Plus
de dix milles jeunes délinquants britanniques sont emprisonnés.
«Le bilan du Royaume-Uni en terme d'emprisonnement des enfants est
l'un des pires qui se puisse trouver en Europe.»
 Les
frais très élevés d’inscription universitaire dissuadent
les étudiants issus de familles modestes de s’inscrire en fac. Les
frais très élevés d’inscription universitaire dissuadent
les étudiants issus de familles modestes de s’inscrire en fac.
 De
plus en plus d’étudiantes se prostituent ou travaillent dans l’industrie
du sexe pour payer les frais d’inscription de leur université. De
plus en plus d’étudiantes se prostituent ou travaillent dans l’industrie
du sexe pour payer les frais d’inscription de leur université.
 Plus de 350 000 Britanniques ont quitté leur île en 2005 pour
jouir d'une vie meilleure
Plus de 350 000 Britanniques ont quitté leur île en 2005 pour
jouir d'une vie meilleure
Les
jeunes Britanniques se voient vivre ailleurs. Difficulté d'
acquérir un logement, hausse de la fiscalité et indigence
des services publics, en particulier les transports et le système
de soins.
 M.
Ernest-Antoine Sellière, alors président du patronat français
:«
Je suis un socialiste britannique » M.
Ernest-Antoine Sellière, alors président du patronat français
:«
Je suis un socialiste britannique »
 Londres,
paradis des milliardaires. Londres,
paradis des milliardaires.
 Selon
des rapports de l’ONU et de la Banque mondiale : « Au Royaume-Uni,
les inégalités entre riches et pauvres sont les plus importantes
du monde occidental, comparables à celles qui existent au Nigeria,
et plus profondes que celles que l’on trouve, par exemple, à la
Jamaïque, au Sri Lanka ou en Ethiopie .» Selon
des rapports de l’ONU et de la Banque mondiale : « Au Royaume-Uni,
les inégalités entre riches et pauvres sont les plus importantes
du monde occidental, comparables à celles qui existent au Nigeria,
et plus profondes que celles que l’on trouve, par exemple, à la
Jamaïque, au Sri Lanka ou en Ethiopie .»
 Grande Bretagne : premier
pays où chaque déplacement de véhicule sera enregistré.
Grande Bretagne : premier
pays où chaque déplacement de véhicule sera enregistré.
 Les
Britanniques inventent l'ultrason antijeunes. Les
Britanniques inventent l'ultrason antijeunes.
 De
plus en plus de mineurs hospitalisés pour des problèmes d'alcool.
Le nombre de mineurs hospitalisés en Angleterre pour avoir trop
bu a augmenté de 20% en un an. De
plus en plus de mineurs hospitalisés pour des problèmes d'alcool.
Le nombre de mineurs hospitalisés en Angleterre pour avoir trop
bu a augmenté de 20% en un an.
AMERICAN
WAY OF LIFE...
 "Je
t'aime, Alex" : 4 mois de redressement. "Je
t'aime, Alex" : 4 mois de redressement.

Lourde peine pour une
écolière amoureuse.
Une jeune fille de 12 ans
ayant écrit «Je t’aime Alex» sur les murs d’une
école, a été envoyée pour 4 mois dans un établissement
"accueillant" des élèves "en difficulté". Parmi de
nombreuses autres jolies colonies de vacances du même type : Tranquillity
bay". gérée par la WWASP (patronnée par le
professeur Skinner, le père de la psychologie comportementaliste).
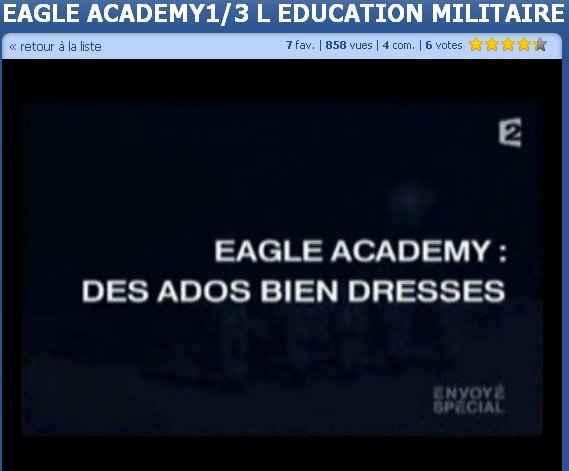
Pour 3000 dollars par mois,
il promet de transformer ces récalcitrants en citoyens dociles et
travailleurs.
Les
écoles publiques en Californie :
"Sodome
et Gomorrhe" !
USA 2008 :"dans
le Milwaukee, il n'y a pas eu de miracle" (Sol Stern).
LES
CHÈQUES "ÉDUCATION" : L'ÉCHEC.
Depuis une bonne vingtaine
d'années, ici aussi, le "chèque éducation"
(ou "bon scolaire") - en anglais "voucher" -
fait partie d'un blabla
yakaiste au sujet des indispensables réformes, "simples, urgentes
et radicales", disent-ils, du système scolaire...
L'un des plus fervents
promoteurs du chèque-éducation aux USA, Sol Stern,
vient de faire brusquement volte-face en affirmant, constats à l'appui,
que le voucher n’avait "pas du tout amélioré le
système public".
Après avoir depuis
longtemps réclamé, soutenu et contribué au développement
des vouchers et des charter schools, Sol Stern pointe les
défauts et les insuffisances du voucher. Il cite, entre autres,
l’expérimentation de Milwaukee, première ville aux États-Unis
à adopter, en 1990, un programme "chèque éducation".
«Tout
le monde est pour la mixité sociale. Mais pour les autres.»
Le
droit d'apprendre
Ivan
Illich dans
Une société sans école proposait,
dès les années 70, une réflexion radicale sur l'échec
de l'enseignement à l'école.
Cette dernière,
outil d'un Etat,
peut-elle être
pensée aujourd'hui autrement
comme il le suggérait
il y a trente ans ?
Des écoles
Des collèges
et des lycées
Oui,
mais ... pas trop !
Statiques
universitaires-fonctionnaires ou camelots très agités ont
en commun, depuis deux bonnes décennies radoteuses sur l’échec
scolaire, l’art et la pratique du piratage et de son exploitation en produits
dérivés et contre-faits.
NON,
les écoles différentes ne sont pas les écoles
parallèles
(à
quoi ?), souvent mortes-nées, dont tout le monde parle depuis 30
ans sans jamais (vouloir) savoir de quoi il s’agit/s’agissait : alternativement
synonymes de "dernière chance", de "pas mal, ... pourles
autres", le terme étant souvent affublé de "post-soixanthuitardes"
par tous ceux parvenus, et qui en sont
revenus sans y être jamais allés; précédé
de «ça marginalise un peu,
quelque part, au niveau de la socialisation, quand même, non ?»
ou suivi de «qu’est-ce que ça
serait bien si qu'on en ferait une».
«
Main basse sur l'école publique »
L'Éducation
Nationale est accusée de « fabriquer des crétins
» et d'entretenir le « chaos pédagogique »,
l'insécurité et le chômage. Eddy Khaldi et Muriel Fitoussi
dévoilent la signification de ces mesures : des associations de
libéraux et de catholiques conservateurs proches du Front national
et de l'Opus Dei sont à l'origine de ces propositions.
Au
nom de la liberté de choix, on prépare une privatisation
de l'Éducation. |
Archives
(1978)
Faire bouger Goliath
Henri Dougier
Quand on parle de l'école
aujourd'hui, on ne trouve pas de mots assez durs pour stigmatiser ses faiblesses,
ses carences. Chacun a son histoire, ses anecdotes, plus péjoratives
les unes que les autres, qui ne fleurent guère la nostalgie ...
On est loin de Pagnol ou de Gaston Bonheur! L'instit passionné,
l'apprentissage de la vie, l'initiation, la rencontre privilégiée
de l'adulte ... tout cela paraît bien mythique.
Et pourtant on a beau rechigner,
on les envoie à l'école nos enfants, comme tout le monde!
Avec devoirs du soir, notes sans notes, les « colles », la
fête annuelle et de rares contacts avec les enseignants. Et, bien
sûr, la même absence de « ferveur » et d'enthousiasme
chez les enfants ... Bref, le schéma habituel. Pas de déviations,
ou si peu.
Comment attaquer un tel bastion,
quand on voit ceux-là même qui en sont les victimes le défendre
ou du moins ne pas oser le remettre en cause? Comment dégonfler
un tel mythe, quand on sait à quelle profondeur il imprègne
nos comportements et notre modèle de relations sociales?
Dénoncer les carences ou
l'inutilité de l'école, cela a été fait maintes
et maintes fois et les pamphlets visiblement ne servent à rien.
Alors que faire, passer à l'acte, mais qui va oser faire bouger
Goliath?
Quelques individus isolés,
quelques insoumis aux méthodes contestables ont osé et bravent
depuis quelques années une forêt d'interdits. C'est à
eux que ce « dossier » est consacré, à leurs
expériences sur le terrain.
Ils ne sont pas nombreux, une douzaine
de lieux éparpillés en France, regroupant environ 200 enfants
... un vrai grain de sable! Mais la survie de leurs expériences,
la franchise de leurs témoignages, l'analyse fouillée de
leurs finalités, de leurs obstacles, de leurs échecs soulèvent
toutes les questions importantes. Toutes celles que parents, enseignants
et élèves devraient se poser, devraient discuter.
Qu'on n'attende pas ici un regard
complaisant et complice sur des marginalités délicieusement
excitantes, parce que lointaines et exotiques ... la critique, l'autocritique
sont permanentes et le « dossier », bâti par des enquêteurs
certes partisans et militants, Catherine Baker et Jules Chancel, est soumis
à un feu roulant de questions, de remises en cause venant d'observateurs
parfois impitoyables: Fernand Oury, Fernand Deligny, Etienne Verne, Louis
Legrand ..., entre autres, apportent au débat le poids de leurs
propres tentatives.
On souhaiterait que ce document
sur les alternatives à l'école, les « lieux de vie
» parents-enfants - où interviennent pour la première
fois tous les protagonistes - provoque ici et là une mise en question
des choses acquises.
Faire bouger Goliath, c'est la clé
de tout changement social en France, personne n'en doute. Et c'est au niveau
des parents que ça se joue. Pas vraiment ailleurs. C'est aux parents
de faire la vérité sur leurs propres expériences,
de ne pas totalement déléguer à d'autres une quinzaine
d'années de vie de leurs enfants et d'eux-mêmes. Quinze ans!
Ces pratiques
alternatives : un modèle?
Des lieux « pour enfants
» où s'inventent d'autres rapports
C. Baker
Journaliste, mère d'une petite fille
de 9 ans, enfant déscolarisé.
J. Chancel
Enseignant à Dauphine, père
d'une fille, Judith, enfant déscolarisé.
Les choses ne sont pas claires.
«
Ecole parallèle », c'est une notion assez rèpandue;
cela dit quelque chose. La grande presse en parle à l'occasion,
et le ton général des articles laisse accroire qu'il s'agit
d'une sorte de nouvelle institution bien installée dans le folklore
des déviances permises. Communauté, auto-stop, sexualité
guillerette et école paralléle, tout ça marche ensemble.
C'est presque un créneau publicitaire: ce sont « ces clients-là
», hirsutes et fleuris, qu'acceptent, débonnaires, de servir
et d'illustrer dans leurs pubs, les compagnies pétrolières
et les grandes banques nationalisées.
Pourtant, à y regarder de
plus près, on peut constater très vite deux choses: on ne
sait pas très bien ce que signifie l'expression « école
paralléle » et en France tout au moins, le phénomène
est tout à fait minoritaire. Il y a, à cet égard,
une distorsion remarquable entre la rumeur et le fait réel.
Alors, pourquoi ce dossier? On
peut répondre d'abord en citant cet aphorisme soixante-huitard:
« Le qualitatif est notre force de frappe ». Le phénomène
est intéressant pour ce qu'il est autant que pour ce qu'il représente.
Une critique vécue du système officiel d'éducation,
des pratiques sociales suffisamment radicales valent la peine d'être
étudiées, d'être connues, même si elles restent
pour le moment très isolées.
D'autre part, on observe, ces derniers
temps, une recrudescence de projets qui se font, se défont, se rêvent
et se recommencent. Tous les jours, dans les petites annonces de Libération,
on peut lire des appels de parents, d'adolescents, pour que se constituent,
en Provence, en Alsace, à Paris, des écoles parallèles,
des collectifs d'enfants et d'adultes, des lieux diffèrents de la
norme officielle. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, depuis longtemps
déjà, des écoles parallèles se sont créées,
des pratiques critiques ont contré l'enseignement existant, des
livres ont été publiés.
En France, le système scolaire
est à ce point pesant, et en même temps accepté, que,
jusqu'à ces dernières années, une véritable
alternative à l'école n'a pu prendre de l'ampleur. Peut-on
alors en conclure qu'aujourd'hui enfin un mouvement de l'école en
tant qu'école commencerait à se manifester dans ce pays?
Ce serait bien rapide. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est que, dans un
certain milieu, orienté généralement à gauche
de la gauche, on se pose des questions. On peut dire aussi qu'un certain
nombre
d'enfants, d'adolescents, nés un peu avant ou après 68, savent
que désormais leur refus de l'école n'est plus une révolte
impossible et que ce rejet fondamental peut se justifier, être entendu,
être vécu.
La légion des sceptiques
/.../
On a parlé aussi d'ambition.
De Rastignac des maternelles.
En fait, c'est une volonté
politique qui s'exprime là. Animer pour soi, pour ses enfants, une
école parallèle, un collectif de vie, c'est une démarche
politique: un lieu, des rapports dans ce lieu; un endroit, une pratique;
un autre rapport à l'enfant, un autre rapport à la parentalité,
mais aussi l'affirmation de cette pratique par rapport à la pratique
dominante, gigantesque, du système de l'Education nationale.
Il convient de mettre tout de suite
le doigt sur un point essentiel. Mettre son enfant dans une école
parallèle, c'est un choix important, qui signifie, qu'on le veuille
ou non, une prise de position politique. Non seulement on rejette pour
son enfant la répression et la hiérarchie du système
officiel, mais on refuse aussi la spécialisation, la séparation
qui marque le fonctionnement de toutes les institutions. Bref, on est intégré,
vaille que vaille, à une pratique anti-institutionnelle. Et c'est
bien là qu'on voit qu'il ne s'agit pas seulement de pédagogie
nouvelle ou d'éducation permissive.
L'école parallèle
ne représente pas uniquement une bouffée de liberté
pour les gosses. C'est aussi une pratique délibérée
de rupture avec l'idéologie dominante. En d'autres termes, une critique
de l'éducation ne se justifie pas seulement par des éléments
« négatifs» (contre l'école, contre la discipline),
mais aussi par des choix positifs (une pratique de rupture, un objectif
politique).
Définitions délicates
On peut essayer dès maintenant
de présenter ce qu'on pourrait appeler pompeusement des lieux différents
pour enfants : école de pointe, école nouvelle, école
parallèle, collectifs d'enfants et d'adultes .
Les écoles de pointe,
ce sont bien sûr les établissements scolaires de l'Education
nationale où sont favorisées des pratiques pédagogiques,
voire (mais les limites ne sont pas extensibles) des rapports nouveaux
au sein même du fonctionnement institutionnel. Parmi les plus connues,
il y a l'école de la rue Vitruve à Paris (20°), l'école
Decroly à Saint-Mandé, l'école des Buttes à
la Villeneuve de Grenoble ...
Sans mettre en cause la qualité
des efforts consentis dans l'un et l'autre cas, écoles de pointe
et parallèles s'adressent mutuellement des critiques fondamentales.
Du côté parallèle, on dira: « Oui, c'est sûr,
dans ces écoles de pointe, ils sont pleins de bonne volonté,
certainement pas répressifs, ils ont des moyens, mais c'est l'institution,
et dans l'institution on ne peut pas remettre en cause ces données
de base que sont la spécialisation des rôles, le pouvoir de
l'Etat, la séparation entre pratique et vécu » ...
Les critiques venant du côté
des écoles de pointe à l'encontre des parallèles se
font, elles, sur un registre social: « Vous, les écoles parallèles,
vous ne recrutez que dans un milieu bien favorisé, au moins d'un
point de vue culturel. Votre expérience s'appauvrit de ce fait.
Sur le plan pédagogique, vous manquez d'imagination, parce que vous
n'avez pas à en avoir. De toute façon, vos gosses, en dignes
enfants d'intellectuels, sauront, comme papa, comme maman, manier les phrases
et les concepts ». On reprendra ces arguments plus loin .
Les écoles nouvelles
sont des écoles privées, reconnues par l'Etat. Elles sont
prises en charge par des spécialistes (instituteurs, professeurs
et directeur). Ces écoles sont nouvelles dans la mesure où
elles tentent une pédagogie non-directive et impliquent la participation
des parents. Cette non-directivité est évidemment relative,
que ce soit au niveau de l'autonomie des groupes d'enfants et des enseignements;
relative aussi, la plus ou moins réelle participation des parents.
Certaines de ces « écoles
nouvelles » revendiquent le droit de s'inscrire en contrepoint de
l'école traditionnelle et d'être reconnues comme parallèles.
Les plus sourcilleux parmi les tenants de l'école parallèle
n'acceptent guère de leur accorder le « prestigieux label
» ... ou les estiment trop directives, trop structurées, trop
onéreuses (600 F/mois et par enfant) pour cela. Pourtant, toutes
les écoles nouvelles ne présentent pas toutes ces «
tares » à la fois et, sur un mode mineur, elles contribuent
aussi à ébranler l'édifice oppressant du système
de l'éducation traditionnelle et française.
On en arrive - et le cercle se
restreint - au noyau dur, au noyau pur de l'éducation critique:
école parallèle et collectif d'enfants et d'adultes .
La définition de l'école
parallèle est difficile à formuler dans la mesure où
les deux termes «école» et « parallèle
» sont eux-mêmes critiqués. S'agit-il, dans ces «
lieux pour enfants », d'école? Certains disent oui, d'autres
non. En réalité, de part et d'autre, un jeu de mots. Ce n'est
pas une école, mais « à la place de l'école
». Dans l'idée de parallèle, il y avait l'idée
de deux lignes qui ne se rencontreraient pas. On parlait aussi de réseaux
parallèles de distribution, de presse parallèle, etc. «
Parallèle », « marginal » se confondent souvent.
Le contenu sous-jacent aux deux mots réside dans la contestation
politique de l'idéologie qui nous domine: c'est la contre-culture.
L'ennuyeux, c'est que « parallèle » signifie aussi «
qui va dans la même direction ».
On les a appelés aussi «
écoles sauvages », comme les plantes, mais aussi comme les
animaux non domestiques; liberté, mais aussi défenses, toutes
griffes dehors. C'était mieux, mais l'inconvénient, cependant,
c'est que les mots s'usent. On discourt, on discourt, on analyse, on analyse
et ne restent plus rien des qualificatifs, puis des noms. Demeurent les
verbes, les actes. Tout se complique encore du fait que, si des écoles
nouvelles se font appeler parallèles, des écoles «parallèles»
refusent catégoriquement ce terme qui les marginalise.
Nous avons choisi ici, humblement,
d'appeler « les écoles parallèles » des «
lieux pour enfants ». Il existe d'autres initiatives, telle celle
d'Evolène (*),
qui pourraient revendiquer la même appellation; nous précisons
donc qu'il s'agit des lieux « à la place » de l'école,
qui fonctionnent, au minimum, en son temps dit « scolaire »,
c'est-à-dire à peu près de 8 h à 18 h, du lundi
au samedi, de septembre à juin. Ces lieux pour enfants sont aussi,
la plupart du temps, des lieux pour adultes, parents ou non. Mais ils ont
en commun de n'exister qu'à cause des enfants, afin de créer
de nouveaux rapports entre les adultes et eux.
Enfin, quand nous disons «
lieu », nous n'entendons pas « endroit », mais espace
qui peut être multiple. Beaucoup de ce qu'on appelait « écoles
parallèles » fonctionnent, du moins idéalement, en
relation avec des « réseaux » dispersés un peu
partout dans la vie. Des « sympathisants » de ces lieux reçoivent
des enfants, leur transmettent un certain savoir. Il y a aussi des lieux
qui flottent sur la Méditerranée et des projets de mise en
relation avec les routiers.
(*) "Enfants
Libres D'Evolène" (Catherine Albouy, Hélène Cantin,
Henri Claustre, Guy Coquet).
Editions Rougemont, Lausanne, 1974
La tendresse aussi
Petit à petit l'utopie de
« Encore heureux qu'on va vers l'été » se faufile
dans la réalité: il existe des lieux pour enfants et des
réseaux de « complices », fermiers, chauffeurs P.L.,
marins, professeurs, etc. Et si la règle du masculin l'emporte au
niveau de la grammaire, c'est provisoire; au niveau de la vie, il est notable
que se sont les femmes qui se battent le plus aujourd'hui contre l'école.
Il s'agit dans ces lieux de sortir
le plus possible de la logique scolaire, c'est-à-dire non pas seulement
de la discipline, de la compétition et de l'effort pénible
érigé en norme du travail, mais de la séparation entre
l'école et la vie. L'anti-autoritarisme y est la moindre des choses.
Nul n'a le droit d'imposer son pouvoir, et l'anti-autoritarisme ne signifiant
certes pas « laisser faire », ce n'est pas l'un des moindres
sujets de lutte avec les enfants. Encore faut-il croire que ce combat n'est
pas sans issue; encore faut-il avoir confiance en nos désirs.
On propose donc aux enfants un
lieu où ils pourront s'exprimer et en même temps comprendre
que le processus dans lequel ils sont ainsi intégrés est
un processus critique. On s'efforce, à partir de là, de mettre
sur pied un fonctionnement collectif, où toutes les personnes, adultes
et enfants, sans statut figé, prennent en charge la gestion de ce
lieu. Or, à ce niveau, il semble bien que ce qu'on appelait école
parallèle se heurte à une contradiction indépassable.
Quoiqu'on en veuille, elle reste limitée à la journée
et à la « période scolaire» ; elle est limitée
aussi et peut-être surtout par la famille, qui ponctue de manière
privative une amorce de fonctionnement collectif.
C'est contre cette séparation
entre un lieu déterminé par le temps scolaire et le lieu
de la vie que se fonde le projet collectif. Collectif d'enfants et d'adultes,
cela signifie d'abord prise en charge collective des enfants (ne pas confondre
avec « décharge »). Les parents de ces collectifs peuvent
très bien s'occuper de tous les enfants et conserver des relations
privilégiées avec les leurs; il ne s'agit pas d'une «
collectivation » sans liens affectifs particuliers; la précision
serait ridicule, si le mot « collectif» n'avait été
terni par de froides histoires de kibboutzim, de communes chinoises, etc.
Mais cette tendresse n'en est pas
moins un essai de dépassement de la structure familiale. L'idée
de rythme, de durée, de continuité, exprime assez bien cette
volonté de comprendre et éventuellement de casser avec les
enfants les blocages et les limites posés par la culture dans la
sphère dite du quotidien.
L'Etat reconnaissant. .. ou pas?
On a vu que des « écoles
parallèles » s'étaient fait reconnaître par l'Etat
(Terrevigne, Le Har, par exemple) alors que d'autres, beaucoup moins nombreuses
(La Barque, la Commune) y sont hostiles. La reconnaissance par l'Etat implique
un contrôle de la sécurité des locaux par l'Inspection
d'Académie, et du niveau scolaire des enfants à 8, 10 et
12 ans, ce dernier contrôle étant le même que celui,
individuel, concernant les enfants « déscolarisés ».
Elle permet à chaque enfant de pouvoir obtenir à sa sortie
de l'établissement un livret scolaire. Eventuellement, l'école
ainsi «reconnue» peut bénéficier de (maigres)
subventions.
Les tenants de la reconnaissance
par l'Etat ont deux arguments : « ne pas se couper du peuple »
et « prendre l'argent là où il est ». Ne pas
se couper du peuple s'oppose ici à « se marginaliser »
; dans l'esprit de ceux qui ont choisi cette solution, le mot « déscolariser
» est un mot de luxe que ne saurait assumer qu'une mince frange de
la petite bourgeoisie intellectuelle. Il s'agit donc de faire admettre,
avec la garantie de l'Etat, que ce lieu pour enfants est une école,
une vraie.
D'autres simplement se sont débattus
avec des difficultés financières insupportables; ils espèrent
par la fameuse reconnaissance de l'Etat obtenir quelques sous. Disons tout
de suite que s'il n'y a pas de contrat d'association (et nous ne pouvons
plus parler alors d'« école parallèle ») les
subventions sont quasiment inexistantes.
Les adversaires de la reconnaissance
par l'Etat ont une position radicalement libertaire: par besoin de Papa-Etat
pour exister, la contestation de l'Education nationale, c'est aussi la
contestation de «l'Etat mangeur d'hommes ». Ils ne veulent
pas de la garantie étatique, refusent d'être l'alibi du libéralisme.
De droite ou de gauche, l'Etat, s'il n'est pas remis en question en tant
que tel, est une atteinte à la liberté individuelle et collective.
« L'école parallèle»
apparaît dans cette optique comme la prise en charge collective et
non statutaire des moyens qu'on se donne de s'exprimer et de se comprendre,
soi et les autres, dès la plus petite enfance. Cette prise en charge
de la vie quotidienne désirante est intrinsèquement une critique
de la vie canalisée par l'Etat. Dans les villes, au même titre
que toutes les initiatives « de quartiers» qui visent à
une autonomie de type « communard » des lieux de vie, les «
écoles parallèles » sont une démarche vers une
communauté idéologique capable d'opposer une résistance
active aux ennemis de classe, organisateurs de l'ennui. Dans les campagnes,
elles sont le signe de la recherche d'un rythme naturel de chacune de nos
vies; elles s'opposent à la précipitation érigée
en loi de fonctionnement de notre civilisation. Des deux côtés,
ces « lieux pour enfants » prouvent le Mouvement en marchant.
Des collectifs de vie.
Résumons-nous:
1) Le rejet de l'école en
tant qu'école, en France, est un phénomène encore
très minoritaire.
2) Le rejet de l'école implique
une démarche politique: choix anti-institutionnel, pratique sociale
collective, remise en cause de la famille, du salariat. .. et du reste.
3) Les écoles parallèles
sont elles-mêmes traversées de contradictions qui tiennent
aussi bien à leur recrutement social qu'à leur fonctionnement
interne.
On l'a déjà entrevu
à propos de la question de la reconnaissance par l'Etat: ou bien,
on refuse cette reconnaissance et l'on bute sur des questions matérielles
aux conséquences discriminantes (pas de subventions, perte possible
des allocations familiales ... ) ou on l'accepte, et l'on est susceptible
de subir un contrôle et une logique dont les effets tendent à
laminer les velléités des pratiques de rupture. Par ailleurs,
le fonctionnement même de l'école parallèle qui se
fonde sur une séparation entre le lieu (spécialisé)
des enfants et la famille affaiblit la possibilité d'une pratique
radicale. En ce sens, le fonctionnement en collectif de vie pour enfants
et pour adultes va beaucoup plus loin.
En tout état de cause, on
peut reconnaître que la question d'un lieu de liberté pour
les enfants est une question urgente. «
Les enfants d'abord », écrit Christiane Rochefort.
Elle a raison, mais il faut que le reste suive. On ne peut pas accepter
que se perpétue, sans opposition radicale, un système scolaire
qui accentue encore aujourd'hui son caractère oppressif et sélectionniste
(réforme Haby). On ne peut accepter qu'une logique absurde continue
de s'appliquer au mépris du libre épanouissement des enfants.
On ne peut pas accepter qu'un inspecteur de l'Education nationale visitant
une école écrive dans son rapport que la cour de récréation
présente des irrégularités, puisqu'il y pousse des
arbres et que les enfants peuvent en profiter pour se cacher derriére
(ce délire panoptique est authentique; il figure dans un rapport
concernant une école du Beaujolais - Académie de Lyon)
On comprendra alors l'ambition
de ce numéro où, non seulement on a voulu justifier une pratique,
mais en montrer tous les développements possibles: aux témoignages,
aux critiques on a tenu à ajouter une partie théorique (une
théorie pour rire), où l'on s'efforce aussi bien de répondre
aux objections et notamment aux objections « sociales » - que
d'imaginer ce que pourrait être un autre rapport entre adultes et
enfants.
La loi ne vous interdit pas d'innover
...
La loi du 28 mars 1882, modifiée
par les lois des 11 août 1936 et 22 mai 1946, et par l'ordonnance
du 6 janvier 1959, établit l'obligation scolaire pour les enfants
de 6 à 16 ans.
Mais son article 4 stipule: «
L'instruction primaire est obligatoire pour les enfants des deux sexes,
français et étrangers, âgés de 6 à 14
ans révolus (la limite d'âge est passée à 16
ans, ordonnance du 6.1.1959); elle peut être donnée soit dans
les établissements d'instruction primaire ou secondaire, soit dans
les écoles publiques ou libres, soit dans les familles, par le père
de famille lui-même ou par toute personne qu'il aura choisie. »
« Au cours du semestre de
l'année civile où un enfant atteint l'âge de 6 ans,
les personnes responsables doivent, quinze jours au moins avant la rentrée
des classes, soit le faire inscrire dans une école publique ou privée,
soit déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie
qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. »
L'article 2 du décret du
18 février 1966 stipule: « [ ... ] Dans le cas où ces
personnes [les parents] ont déclaré au maire et à
l'inspecteur d'académie qu'elles lui feront donner l'instruction
dans la famille, l'inspecteur d'académie ou son délégué
accuse réception de leur déclaration. »
L'article 9 du décret du
18 février 1966 stipule notamment: « Le versement des prestations
familiales afférentes à un enfant soumis à l'obligation
scolaire est subordonné à la présentation soit du
certificat d'inscription dans un établissement d'enseignement public
ou privé, soit d'un certificat de l'inspecteur d'académie
ou de son délégué attestant que l'enfant est instruit
dans sa famille, soit d'un certificat médical attestant qu'il ne
peut fréquenter régulièrement aucun établissement
d'enseignement en raison de son état de santé.
L'article 16 de la loi du 28 mars
1882, modifiée par la loi du Il août 1936, précise:
« Les enfants qui reçoivent l'instruction dans leur famille
sont, à l'âge de 8 ans, de 10 ans et 12 ans, l'objet d'une
enquête sommaire de la mairie compétente, uniquement aux fins
d'établir quelles sont les raisons alléguées par les
personnes responsables et s'ils leur est donné une instruction dans
la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions
de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué
à l'inspecteur primaire.
« Ce dernier peut demander
à l'inspecteur d'académie de désigner des personnes
aptes à se rendre compte de l'état physique et intellectuel
de l'enfant. Ces personnes pourront l'examiner sur les notions élémentaires
de lecture, d'écriture et de calcul, et proposer, le cas échéant,
à l'autorité compétente les mesures qui lui paraîtraient
nécessaires en présence d'illettrés.
« Notification de cet avis
sera faite aux personnes responsables, avec l'indication du délai
dans lequel elles devront fournir leurs explications ou améliorer
la situation, et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas
contraire, par application de la présente loi. »
|