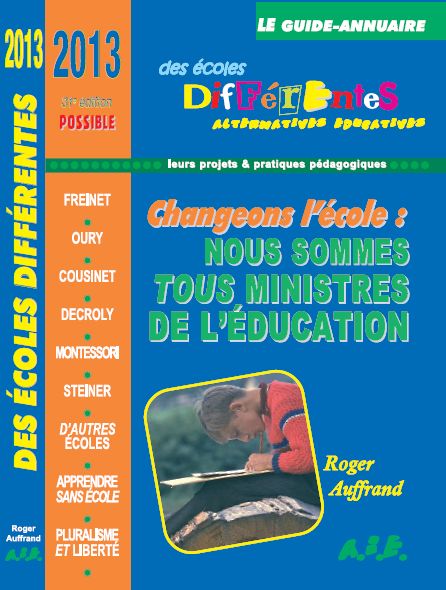Une
étude officielle montre l'inutilité du redoublement brut
Le
redoublement frappe par son "caractère massif".
Il
touche "tous les milieux sociaux" à l'exception notable des enfants
d'enseignants qui présentent un risque deux fois moins élevé
que les enfants d'employés de service ou d'ouvriers non qualifiés
de redoubler.
La
France détient le record mondial des redoublements
alors qu'elle dépense
davantage pour ses collèges et lycées que la moyenne des
pays de l'OCDE
Elèves
absents, décrocheurs, décrochés...
1% des 3,25 millions
de collégiens que compte la France seraient déscolarisés.
Ce phénomène
s'opère le plus souvent entre 14 et 16 ans.
Les filles sont presque
autant concernées que les garçons.
5% des élèves
du second degré sont absents plus de quatre demi-journées
par mois.
La moitié des collèges
et lycées ayant participé à l'enquête «la
Déscolarisation» comptabilisent 2 % d'élèves
absentéistes, mais un sur dix en enregistre 15 %.
Le décrochage scolaire,
qui désigne les jeunes en voie de déscolarisation, touche
8% d'une classe d'âge, soit 60 000 jeunes par an en France,
selon une étude de
l'Education nationale en 2001.
 France : Nouvelle "Innovation" innovante (Académie
de Créteil - Rentrée 2008-2009)
France : Nouvelle "Innovation" innovante (Académie
de Créteil - Rentrée 2008-2009)
Pour les décrocheurs-
ou déjà "décrochés" - de plus de 16 ans : une
annexe (3 classes d'une douzaine d'élèves)
Les
16-18 ans en France et en Europe
Entre 16 et 18 ans, les
jeunes dépourvus de diplôme et qui ne sont plus en formation
voient leur insertion immédiate et future durablement compromise.
Le
fond de la classe au premier rang
Ils ne sont pas là
tout à fait par hasard. Leur scolarité a été
une longue suite d’échecs, souvent dès le CP.
Habitués des fonds
de classe, la plupart ont acquis la conviction qu’ils étaient nuls,
tout juste bons à faire le pitre ou à tenir tête au
principal pour exister.
Vote de la
loi de prévention de la délinquance :
l'Assemblée
renforce la lutte contre l'absentéisme à l'école
et étend le contrôle
de "l'obligation scolaire" aux élèves inscrits à des
cours à distance,
y compris ceux agréés
par l'Education nationale (CNED et cours privés)
(homeschooling, instruction
en famille, école à la maison, éducation à
domicile, etc...)
BRITISH
WAY OF LIFE
Le "modèle"
anglo-saxon, libéral ... et blairo-socialiste...
 ÉCOLES
ANGLAISES : ÉCOLES
ANGLAISES :
Discipline, rigueur et esprit
compétitif sont les maîtres mots de la mutation mise en œuvre
par le gouvernement travailliste..
 Royaume-Uni
: L’uniforme discriminatoire Royaume-Uni
: L’uniforme discriminatoire
En imposant un fournisseur
unique pour l’achat de l’uniforme, les écoles pratiquent une discrimination
à l’encontre des élèves pauvres.
 Directeur
d'école en Grande Bretagne : Directeur
d'école en Grande Bretagne :
« Le métier
a beaucoup évolué. Aujourd’hui, on est beaucoup plus responsable,
on a plus de pression, on nous demande plus de résultats. »
 Deux
fois plus d’enseignants sont partis en retraite
anticipée au cours des sept dernières années. Deux
fois plus d’enseignants sont partis en retraite
anticipée au cours des sept dernières années.
 35%
des élèves de 11 ans ne savent pas lire. 35%
des élèves de 11 ans ne savent pas lire.
 Un
ado sur cinq ne peut situer son pays sur une carte. Un
ado sur cinq ne peut situer son pays sur une carte.
 Ecoles
publiques fermées aux pauvres. Un rapport émis
par ConfEd, (une association qui représente les dirigeants
du secteur de l’éducation locale) dénonce le manque d’intégrité
des processus d’admission dans certaines écoles publiques. Des réunions
de "sélection" d’élèves sont organisées, durant
lesquelles ne sont admis que les enfants "gentils, brillants et riches".
Ainsi, 70 000 parents n’ont pas pu inscrire cette année leurs enfants
dans l’école de leur choix. En écartant les élèves
issus de milieux pauvres, ces établissements "hors la loi" espèrent
rehausser leur taux de réussite aux examens. Ecoles
publiques fermées aux pauvres. Un rapport émis
par ConfEd, (une association qui représente les dirigeants
du secteur de l’éducation locale) dénonce le manque d’intégrité
des processus d’admission dans certaines écoles publiques. Des réunions
de "sélection" d’élèves sont organisées, durant
lesquelles ne sont admis que les enfants "gentils, brillants et riches".
Ainsi, 70 000 parents n’ont pas pu inscrire cette année leurs enfants
dans l’école de leur choix. En écartant les élèves
issus de milieux pauvres, ces établissements "hors la loi" espèrent
rehausser leur taux de réussite aux examens.
 Selon
l'OCDE, les écoles privées britanniques ont les meilleurs
résultats au monde :
FAUX ! Selon
l'OCDE, les écoles privées britanniques ont les meilleurs
résultats au monde :
FAUX !
 ...
& Moins de pauvres dans les écoles primaires catholiques. ...
& Moins de pauvres dans les écoles primaires catholiques.
 Les
écoles anglaises pourront être gérées par des
"trusts". Les
écoles anglaises pourront être gérées par des
"trusts".
 L’école
britannique livrée au patronat. En mars 2000, le Conseil
européen de Lisbonne avait fixé comme principal objectif
à la politique de l’Union en matière d’éducation de
produire un capital humain rentable au service de la compétitivité
économique. L’école
britannique livrée au patronat. En mars 2000, le Conseil
européen de Lisbonne avait fixé comme principal objectif
à la politique de l’Union en matière d’éducation de
produire un capital humain rentable au service de la compétitivité
économique.
 Le
créationnisme aux examens. Le
créationnisme aux examens.
 "BAGUE
DE VIRGINITE" : Une
adolescente anglaise, fille d'un pasteur
évangélique, perd son procès en Haute Cour. "BAGUE
DE VIRGINITE" : Une
adolescente anglaise, fille d'un pasteur
évangélique, perd son procès en Haute Cour.
 Grande-Bretagne
:
l'athéisme (bientôt ?) au programme scolaire Grande-Bretagne
:
l'athéisme (bientôt ?) au programme scolaire
 Grande-Bretagne
:Les
sponsors au secours de l'école Grande-Bretagne
:Les
sponsors au secours de l'école
 Empreintes
digitales pour les enfants d'une école de Londres. Le Royaume-Uni
réfléchit à la mise en place d’une loi pour la création
d’un fichier national des enfants de moins de douze ans. Empreintes
digitales pour les enfants d'une école de Londres. Le Royaume-Uni
réfléchit à la mise en place d’une loi pour la création
d’un fichier national des enfants de moins de douze ans.
 Naître
et grandir pauvre en Grande-Bretagne est encore plus pénalisant
que dans d’autres pays développés. Naître
et grandir pauvre en Grande-Bretagne est encore plus pénalisant
que dans d’autres pays développés.
 Un demi-million de «sans-logement». A
Londres, un enfant sur deux sous le seuil de pauvreté.
Un demi-million de «sans-logement». A
Londres, un enfant sur deux sous le seuil de pauvreté.
 Un
demi-million d'enfants britanniques travaillent "illégalement". Un
demi-million d'enfants britanniques travaillent "illégalement".
 «tolérance
zéro» et conditions de détention intolérables.
Plus
de dix milles jeunes délinquants britanniques sont emprisonnés.
«Le bilan du Royaume-Uni en terme d'emprisonnement des enfants est
l'un des pires qui se puisse trouver en Europe.» «tolérance
zéro» et conditions de détention intolérables.
Plus
de dix milles jeunes délinquants britanniques sont emprisonnés.
«Le bilan du Royaume-Uni en terme d'emprisonnement des enfants est
l'un des pires qui se puisse trouver en Europe.»
 Plus de 350 000 Britanniques ont quitté leur île en 2005 pour
jouir d'une vie meilleure
Plus de 350 000 Britanniques ont quitté leur île en 2005 pour
jouir d'une vie meilleure
Les
jeunes Britanniques se voient vivre ailleurs. Difficulté d'
acquérir un logement, hausse de la fiscalité et indigence
des services publics, en particulier les transports et le système
de soins.
 Selon
des rapports de l’ONU et de la Banque mondiale : «Au Royaume-Uni,
les inégalités entre riches et pauvres sont les plus importantes
du monde occidental, comparables à celles qui existent au Nigeria,
et plus profondes que celles que l’on trouve, par exemple, à la
Jamaïque, au Sri Lanka ou en Ethiopie.» Selon
des rapports de l’ONU et de la Banque mondiale : «Au Royaume-Uni,
les inégalités entre riches et pauvres sont les plus importantes
du monde occidental, comparables à celles qui existent au Nigeria,
et plus profondes que celles que l’on trouve, par exemple, à la
Jamaïque, au Sri Lanka ou en Ethiopie.»
 Les
Britanniques inventent l'ultrason antijeunes. Les
Britanniques inventent l'ultrason antijeunes.
 De
plus en plus de mineurs hospitalisés pour des problèmes d'alcool.
Le nombre de mineurs hospitalisés en Angleterre pour avoir trop
bu a augmenté de 20% en un an. De
plus en plus de mineurs hospitalisés pour des problèmes d'alcool.
Le nombre de mineurs hospitalisés en Angleterre pour avoir trop
bu a augmenté de 20% en un an.
Beuark.
Ségolène
Royal rend hommage à la politique de Tony Blair.
AMERICAN
WAY OF LIFE...
 Lycées,
collèges de Californie : Lycées,
collèges de Californie :
Près
d'un élève sur 4 "décroche" entre 15 et 18
ans
 (rapport du State Department of Education
- 7 juillet 2008)
(rapport du State Department of Education
- 7 juillet 2008) |
L'ennui à l'école,
l'une des causes de la violence
scolaire
Lundi 13 janvier 2003 - Le Monde
85 % des jeunes enseignants se disent confrontés au
manque d'intérêt des
élèves, et un colloque du Conseil national des programmes
doit se pencher,
mardi 14 janvier, sur l'ennui à l'école. Auparavant,
on s'ennuyait poliment.
Aujourd'hui, le chahut a laissé la place à des comportements
plus agressifs.
Les élèves – une partie d'entre eux au moins – s'ennuient
à l'école.
Le constat est probablement aussi vieux que l'école elle-même,
partagé par des
générations successives d'élèves qui n'ont
attendu qu'une seule chose : que
des cours jugés interminables s'achèvent enfin ! La nouveauté,
c'est que
l'institution s'en préoccupe et choisisse d'en faire un thème
de débat. Le
Conseil national des programmes (CNP), chargé de donner
des avis sur le
contenu des enseignements, organise un colloque mardi 14 janvier à
Paris sur
"la culture scolaire et l'ennui" pour amorcer une réflexion
sur le sujet.
L'éducation nationale pouvait-elle d'ailleurs éviter
ce questionnement ?
Un élève qui s'ennuie est un élève qui décroche,
donc potentiellement
perturbateur. L'intéresser, donner plus de sens aux enseignements
apparaît
essentiel dans un contexte où la lutte contre les incivilités
est devenue une
priorité. Mais comment faire ? "L'école doit-elle
résister à la frénésie du
ludique ou s'adapter au règne du divertissement ?", résume,
sous forme
d'interrogation, le CNP, qui a rassemblé des philosophes, des
sociologues et
des chercheurs en sciences de l'éducation pour répondre
à la question.
"ABSENCE DE DÉSIR"
Car il est évident que l'ennui, s'il a toujours existé,
s'est transformé.
"Les élèves avaient appris à s'ennuyer poliment.
Ce qui a changé, c'est que
les élèves l'expriment aujourd'hui dans un langage
qui n'est pas scolairement
acceptable", explique Philippe Meirieu, chercheur en sciences
de l'éducation,
aujourd'hui directeur de l'IUFM de Lyon. Le chahut a laissé
la place à des
comportements plus provocants, plus agressifs. L'ennui s'affiche, il
est
devenu plus "ostensible", selon l'expression de Philippe Meirieu,
qui cite
l'usage de walkman, le maquillage, la lecture de magazines en plein
cours. Du
même coup, les professeurs le vivent sans doute plus difficilement.
85 % des
jeunes enseignants se disent ainsi confrontés régulièrement
au manque
d'intérêt des élèves, selon une enquête
réalisée pour le SNES en mars 2001.
33 % des professeurs de tout âge placent le manque de motivation
comme la
principale difficulté dans leurs relations avec les élèves,
selon une autre
enquête rééalisée pour le SNES en mars 2002.
Les élèves eux-mêmes ne manquent pas de signaler
la profondeur de leur ennui,
lorsqu'on le leur demande. A l'occasion de la consultation sur les
savoirs au
lycée, organisée par Claude Allègre en 1998, les
lycéens avaient ainsi fait
part de leur "absence de désir". Certaines matières
avaient recueilli tous
les suffrages, signe du désintérêt des élèves
: la grammaire, la géologie,
les dates en histoire, les vecteurs en mathématiques sont, pour
les élèves,
des disciplines qui "endorment", selon leurs propres mots. La
critique
portait également sur certaines activités. 72 % des élèves
citaient les
efforts de mémorisation comme particulièrement rébarbatifs,
61 % l'étude de
phénomènes trop éloignés dans le temps
ou l'espace de leur mode de vie, 58 %
l'étude de disciplines jugées secondaires.
"ENFANTS DE LA TÉLÉCOMMANDE"
"Pour les élèves, la vie est ailleurs", résume
Jacques Birouste, professeur
de psychologie, auteur d'une enquête sur l'ennui des lycéens
technologiques.
"Ils ont souvent le sentiment de passer d'une classe à une
autre, d'une
explication à une autre sans faire de lien. Ils ressentent
cela comme une
forme d'atomisation des connaissances", souligne le chercheur,
en insistant
sur l'absence de "rapport libidinal au savoir".
L'école n'est pas restée inerte face au désintérêt
des élèves. Au collège,
par exemple, les itinéraires de découverte visent explicitement
à réveiller
l'attention des élèves en sortant des découpages
disciplinaires
traditionnels. Au lycée, les travaux personnels encadrés
(TPE) sont conçus
pour permettre une "pédagogie active", l'élève
étant amené à conduire un
projet autour d'un thème qui l'intéresse. Au sein des
disciplines, le recours
aux nouvelles technologies réussit à rendre attractives
les matières a priori
les plus rebutantes. Au primaire, l'introduction de la littérature
de
jeunesse, aujourd'hui officiellement recommandée dans les nouveaux
programmes, touche des élèves qui autrement risqueraient
de rester
insensibles à la lecture. Les manuels eux-mêmes se sont
transformés pour être
plus lisibles, mieux hiérarchisés.
Toute la difficulté réside dans le fait que l'ennui est
moins bien accepté
qu'auparavant. Il est devenu, selon le CNP, "le péché
capital de l'âge
contemporain".
"Nous sommes face à des enfants de la télécommande.
Ils ne supportent pas de
ne pas pouvoir agir", explique Philippe Meirieu. "La culture
scolaire s'est
historiquement construite en opposition avec la famille et la religion.
Aujourd'hui, il faut ajouter un autre concurrent : la culture médiatique,
qui
est fondée sur la rapidité, les loisirs", analyse
Gilles Lipovetsky, membre
associé du CNP et professeur de philosophie. Or, pour le philosophe,
"l'école
est le temps de la lenteur", le contraire du "zapping", ce qui
rend l'ennui
"inévitable".
L'ennui, l'ascétisme, l'austérité comme passages
obligés ? Philippe Meirieu
relève que le débat a toujours traversé le milieu
enseignant, divisé entre
tenants de la "pédagogie de l'exercice" – pour lesquels
la répétition, même
fastidieuse, est formatrice – et défenseurs de la "pédagogie
de l'intérêt"
– pour lesquels le travail scolaire doit d'abord partir de l'élève.
Le débat
traverse en réalité chaque professeur. "Cette tension
est féconde. Un bon
maître est celui qui est capable de travailler sur les deux
registres, celui
de l'intérêt des élèves, celui de la
rigueur et de la concentration",
souligne le chercheur.
Pour cette raison, Luc Ferry ne fait pas de la "chasse à l'ennui"
une
priorité. Le ministre de l'éducation nationale, qui avoue
s'être lui-même
"énormément ennuyé" à l'école,
distingue un "bon" et un "mauvais" ennui.
"La culture scolaire n'est pas faite pour être divertissante.
Certains
apprentissages sont difficiles", explique-t-il pour justifier
l'absence de
désir dans certaines disciplines, certaines activités.
"C'est
l'ennui lié à
l'absence de sens qu'il faut combattre. Lorsque l'élève
ne voit pas la
signification de ce qu'il apprend, lorsqu'il a un sentiment d'empilement
des
connaissances, cela me paraît fâcheux", affirme-t-il.
Plus que la recherche
d'activités ludiques, la réflexion sur l'ennui appelle
donc un travail sur le
sens des enseignements.
Luc Bronner
|